Les 7 du Québec
Le sophisme de l'offre et de la demande
!
Robert Bibeau
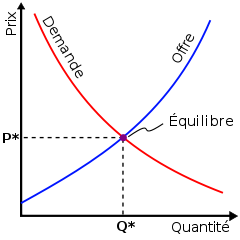
Mercredi 26 octobre 2016
http://www.les7duquebec.com/...
Le
moteur de l’économie capitaliste
Récemment, notre webmagazine a publié un
article présentant la « Loi » de
l’offre et de la demande (1). Pour
comprendre la mystification que
dissimule cette supposée « Loi »,
il faut savoir que vendre – ou répondre
à la demande du marché – n’est
absolument pas le moteur qui propulse le
mode de production capitaliste (2).
Vendre est simplement un moment
nécessaire à la réalisation de la
plus-value, condition requise pour la
reproduction élargie du profit, moteur
et objectif fondamental de la
circulation du capital. En d’autres
termes, produire – soutenir l’offre pour
reprendre l’expression des économistes –
et satisfaire à la demande du marché –
sont des conséquences et non pas un
objectif de ce mode de production dont
la mission fondamentale est de valoriser
le capital.
Chaque
fois que le capital croit avoir déniché
une astuce pour ne pas transiter par le
sillon de la production des marchandises
afin d’assurer sa reproduction élargie,
il s’engage dans cette voie d’évitement
avec le bonheur que l’on connait. Ainsi,
l’astuce d’imprimer de la monnaie à
profusion (QE) ne peut être qu’un pauvre
placébo qui ne sert qu’à retarder et à
aggraver les conséquences de la crise
des capitaux. Nous y reviendrons.
Prix et
valeur
Contrairement à ce que laisse entendre
la « Loi » de l’offre et de la
demande, la « valeur »
marchande d’un produit (qui est
différente de son « prix ») ne
s’établit pas dans la sphère de la
commercialisation, mais dans la sphère
de la production. Quand un produit est
fabriqué ex nihilo et lancé sur le
marché, son prix est déjà fixé. Tout
« solde » (vente à rabais) ou toute
hausse de prix subséquent n’est qu’un
ajustement monétaire. Marx a
démontré qu’en moyenne une marchandise
se vend à sa « valeur ». Si une
marchandise est vendue en dessous de sa
valeur, c’est qu’une autre est vendue
au-dessus de sa valeur. C’est la valeur
qui détermine le prix d’un produit et
non pas le jeu de l’offre et de la
demande, sa rareté ou son abondance ou
une autre marotte d’une supposée « loi
du marché ».
La
valeur marchande d’un produit (ou
d’un service) est équivalente à la
quantité de force de travail qu’il
renferme alors que le prix d’un
produit est la représentation de cette
valeur marchande dans une monnaie
particulière. Ainsi, un produit aura un
prix en euros, un prix en dollars, et un
prix en yuans, etc. En économie
capitaliste, en phase impérialiste, les
économies nationales étant fortement
imbriquées ces prix ont tendance à
s’harmoniser. Par contre, si une banque
centrale (FED) ou multinationale (BCE ou
franc CFA) émet trop de monnaie par
rapport à la « valeur » marchande totale
disponible sur son marché, le prix des
produits aura tendance à augmenter, ce
sera l’inflation des prix alors
que la « valeur » elle restera
inchangée. Ce processus d’ajustement est
indépendant de la « loi » de l’offre et
de la demande et de la « loi » du
marché.
Inflation et déflation
L’inflation (hausse) ou la
déflation (baisse) du prix des
marchandises est un mécanisme
d’ajustement par lequel le « prix »
s’ajuste en fonction de la « valeur – du
taux de change » de la monnaie utilisée
sur un marché national donné.
L’inflation, ou l’augmentation des
« prix » est en réalité une dépréciation
de la « valeur » de la monnaie ce
médiateur universel des échanges. C’est
habituellement dû au fait que trop
d’argent a été injecté sur ce marché par
rapport à la « valeur d’échange »
globale disponible. L’accroissement du
capital « argent-marchand » se fait
habituellement par la propagation du
crédit comme nous l’avons décrit dans un
texte précédent (3).
Cependant chacun aura remarqué que
malgré la profusion de capital monétaire
disponible sur le marché mondial, les
dollars notamment, l’inflation est
jugulée dans la plupart des pays
développés. Comment expliquer cette
incongruité ? C’est que le capital est
extrêmement concentré entre les mains de
quelques privilégiés (et accumulé chez
les banquiers) ce qui signifie que ce
capital n’encombre pas les marchés (de
la production et de la consommation) et
il provoque peu d’inflation des
« prix ». Cette masse de capital liquide
encombre plutôt les marchés boursiers où
elle engendre des surenchères boursières
extravagantes, auxquelles les banques
participent en attendant leur mise en
faillite comme la Deutsche Bank en
était menacé récemment (4). Le groupe
ATTAC, les ONG stipendiées, les
altermondialistes, et d’autres
gauchistes réclament à cor et à cri une
équitable répartition de cette richesse
proposant courageusement que l’on prenne
l’argent des riches pour le donner à la
« classe moyenne ». Vous aurez compris
que ce capital, qui existe réellement –
méfiez-vous des gens qui prétendent
qu’il est « irréel » –, est
spéculativement surévalué. À intervalle
régulier le marché boursier connait des
ajustements ou le capital financier est
dévalué et ramené à sa juste « valeur »
et les actifs transigés restaurer à leur
juste « prix ». Toujours se rappeler que
la « valeur » doit correspondre au temps
de travail dépensé. La « valeur » n’est
pas le résultat des surenchères
spéculatives sur les marchés financiers.
Le
capital sous sa forme monétaire
La
quantité de monnaie de dépôt et de
monnaie de crédit disponible n’a aucune
incidence sur la valeur d’échange. Par
contre, cette variable a une incidence
sur le prix et ultimement sur la demande
de produits. L’émission de monnaie sous
forme de billets de banque ou sous forme
scripturale ou numérique (carte de
crédit, hypothèques, traites, actions,
obligations, etc.) accroit énormément la
quantité de monnaie en circulation,
alors que la monnaie devrait normalement
refléter strictement la valeur marchande
produite. Cette surabondance de monnaie
– surtout sous forme de prêt à intérêt –
modifie la répartition de la plus-value
entre les différents acteurs
économiques. Ce qu’il faut retenir,
c’est que l’émission inconsidérée de
monnaie (sous toutes ses formes) réduit
la valeur de chaque unité (dollar,
etc.). Comme à court terme le salaire
des travailleurs est inélastique ; tout
comme les allocations que l’État
distribue ; ainsi que les prestations de
retraite, tous ces consommateurs, à
revenu fixe, sont confrontés à une
baisse de leur pouvoir d’achat à chaque
augmentation de « prix », à chaque
dévaluation du capital monétaire.
Autrement dit, la portion que ces gens
reçoivent de la valeur d’échange
produite par le travail salarié diminue.
Il en sera de même pour les capitalistes
industriels qui négocient leurs achats
des mois à l’avance. Seuls les
financiers et les banquiers augmentant
le loyer de l’argent (les taux d’intérêt
sur les prêts) pourront ajuster leurs
revenus et s’emparer d’une plus grande
partie de la plus-value, réduisant à la
portion congrue les autres bénéficiaires
(sic).
Cependant, en augmentant la quantité de
monnaie sur le marché les banquiers en
réduisent la « valeur » unitaire en même
temps que la profitabilité. Si le
financier ne peut se renflouer en
augmentant le loyer de l’argent (taux
d’intérêt sur les prêts gelés depuis des
années) il court à la faillite comme le
démontre la dégringolade récente de la
Deutsche Bank (5), et que
l’endettement se généralise à travers le
crédit comme nous l’avons déjà écrit
(6).
La
fixation du « prix » à partir de la
« valeur »
Si
vous souhaitez connaitre la « valeur »
d’une marchandise, additionnez son cout
de production et la plus-value (valeur
ajoutée) qu’elle contient. Des
« valeurs » que le marché des
producteurs et des grossistes fixe bien
avant l’apparition des articles en
magasin. Ainsi, les vêtements
(chemisiers) qui seront offerts à l’été
2017 sont préfinancés en 2016 et
manufacturés une année à l’avance sur
les chaines de montage des « sweats
shops » du Bangladesh, du Vietnam ou de
l’Inde. C’est pendant ce processus de
production que la « valeur » – qui
deviendra un « prix » pour le
consommateur – sera produite en même
temps que la marchandise et à travers
cette marchandise. La production de la
« valeur » d’un chemisier procèdera de
la façon suivante ; le capitaliste
industriel qui aura arraché la commande
obtiendra peut-être une avance qu’il
complètera en contractant un emprunt de
capital – avec ce pécule il achètera du
tissu, du fil, des boutons, de
l’énergie, des machines à coudre, un
vieil édifice chambranlant à Calcutta où
il paiera le prolétariat au plus bas
salaire qui soit et ces salariés
dépenseront une partie de leur temps de
vie au travail à transférer au produit
fini la « valeur » déjà incluse dans les
matières premières, l’énergie, la
machinerie (capital fixe ou Cc) ; une
autre partie de leur temps de vie au
travail sera consacré à produire la
« valeur » de leur force de travail
(salaire ou capital variable ou Cv), et
la dernière partie de leur temps de vie
au travail sera expropriée par le
capitaliste et deviendra le dividende
industriel, mais aussi la rente,
l’intérêt sur le prêt, le profit
commercial, les prélèvements de l’État,
tous les éléments qui, additionnés,
constitueront la « valeur » – mais pas
encore le « prix » – du produit qui sera
mis en marché l’année suivante dans une
boutique de Montréal, à des milliers de
kilomètres de Calcutta. Si ce
manufacturier indien à force
d’ingéniosité perverse parvient à
augmenter la productivité de ses
esclaves salariées en augmentant les
cadences sur la chaine de montage, ou en
innovant pour un gain d’efficacité (gain
de temps et gain de valeur), il vendra
pourtant ses chemisiers au prix
conventionné, empochant au passage une
plus-value extra à l’insu de la « Loi de
l’offre et de la demande », du marchand
et de ses clients, bien avant la mise en
marché des chemisiers. Toujours se
rappeler qu’économiquement parlant,
l’ensemble de ce procédé n’a pas pour
objet de mettre en marché des
chemisiers, mais de valoriser le capital
engagé, de le reproduire et l’accumuler
pour lui faire refaire un nouveau cycle
et profiter.
Le
« prix » d’un produit
Le
« prix » d’un chemisier, préfixé l’an
passé, au moment de le commander, sera
ajusté en fonction de sa « valeur »,
c’est-à-dire en fonction du temps de
travail qu’il contient ; en fonction du
taux de change de la monnaie (ici le
dollar canadien) ; et en fonction des
redevances et des taxes en vigueur au
moment de l’entrée des chemisiers sur le
marché. Il faut se rappeler que le « prix »
d’un produit est la représentation de sa
valeur marchande dans une monnaie
sonnante et trébuchante. Comme on peut
le constater, la rareté ou l’abondance
d’un produit n’ont aucune incidence sur
sa valeur ni sur son prix.
Écologie, environnement, productivisme
Nonobstant la pseudo « loi » de l’offre
et de la demande chacun doit comprendre
que, quel que soit le mode de production
en vigueur, que ce soit sous
l’esclavagisme de la Rome antique, sous
le féodalisme au Moyen-âge, ou sous le
capitalisme industriel, produire des
biens et des services, produire des
marchandises pour satisfaire les besoins
humains impliquera toujours d’extraire,
de transformer et de consommer des
ressources que seule la Terre mère peut
offrir, en attendant de pouvoir les
extraire des astéroïdes.
Ce
n’est pas l’application du sophisme de
la « loi » de l’offre et de la demande,
ou de la « loi » du marché et de la
concurrence qui engendre le « productivisme »,
le « réchauffement climatique »
et les modifications de l’environnement.
Contrairement à ce que prétendent les
petits-bourgeois altermondialistes,
éco-socialistes, écologistes, ainsi que
les apologistes de la pauvreté
volontaire pour les prolétaires, le
grave problème qui confronte les
sociétés humaines vivant sous le
capitalisme en phase impérialiste n’est
pas de nature écologique, climatique,
géographique, démographique, ou
« islamiste » (sic), il est de nature
économique. Ce mode de production ne
parvient plus à valoriser et à
reproduire le capital. Or, c’est sa
mission fondamentale. C’est pourquoi
s’enchainent les cataclysmes
industriels, financiers, monétaires,
boursiers, sociaux, militaires qui
pourraient bien nous conduire à la
guerre nucléaire (7). Conséquemment, au
lieu de tenter de « réformer » ce mode
de production pour le rendre moins
gourmand et plus performant
écologiquement pourquoi ne pas le
détruire en même temps que l’État qui le
gouverne ? Le mode de production
capitaliste fonctionne comme il est
prévu qu’il fonctionne, et ses ratés ne
sont pas causés par une mauvaise
gouvernance, des manigances ou un
complot de Bilderberg, qui ne
sont que de misérables atermoiements
avant la déchéance du système. Rendez
service aux riches, abrégées leurs
souffrances.
Suite
à la révolution prolétarienne ce n’est
pas l’économie socialiste qu’il faudra
construire, mais le mode de production
communiste que le prolétariat devra
ériger, d’ici là camarades, éloigner
« l’avant-garde », nos ennemis on s’en
charge.

(1)
http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/la-loi-de-loffre-et-de-la-demande/
(2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande
(3)
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lendettement-mondial-gravit-de-nouveaux-sommets/
(4)
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lallemagne-et-la-deutsche-bank-dans-loeil-du-cyclone/
(5)
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lallemagne-et-la-deutsche-bank-dans-loeil-du-cyclone/
(6)
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lendettement-mondial-gravit-de-nouveaux-sommets/
(7)
http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-invites/une-guerre-mondiale-devient-plus-probable/
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

