Les 7 du Québec
L'expansion de la classe prolétarienne
Robert Bibeau

Mercredi 18 mai 2016
http://www.les7duquebec.com/...
Notre définition de prolétaire
est concise : « Est prolétaire celui
qui n’a que sa force de travail à mettre
en marché et à monnayer. » C’est une
définition large, elle inclut
pratiquement tout le salariat (excluant
les cadres), les chômeurs, les
sans-travail non recensés en quête
d’emplois. C’est une définition à la
fois sociale et économique. Si tout
travailleur productif est salarié, en
revanche tout salarié n’est pas un
travailleur productif. Certains salariés
sont même des exploiteurs, dès lors
qu’ils administrent le système
d’exploitation de l’homme par l’homme,
les cadres et leurs sous-fifres attachés
à la gouvernance par exemples (1). Marx
a écrit « Par rapport au capitaliste
financier, le capitaliste industriel est
un travailleur, travailleur en tant que
capitaliste, c’est-à-dire un exploiteur
du travail d’autrui » (2).
Qu’est-ce qu’un
prolétaire productif, c’est-à-dire,
qu’est-ce qu’un créateur de plus-value ?
« Pour distinguer le travail
productif du travail improductif, il
suffit de déterminer si le travail
s’échange contre de l’argent proprement
dit ou contre de l’argent-capital (des
moyens de production) ». À partir de
cette définition, Marx donne l’exemple
du littérateur prolétaire de Leipzig
et de la cantatrice travaillant pour un
patron, ils deviennent tous les deux des
travailleurs productifs en ce qu’ils
valorisent le capital ; il dira la même
chose dans une note du tome I de son
livre Das Kapital sur un
enseignant qui travaille dans le secteur
privé.
En effet, on a trop
souvent cette idée que seul le
prolétariat industriel est créateur de
plus-value parce qu’il crée des
marchandises commercialisables. Marx, et
c’est tout l’objet du Capital, démontre
que seul « est productif le travail
qui valorise directement le capital et
ainsi produit de la plus-value ». À
contrario, un artisan qui confectionne
un bout d’étoffe, qu’il troquera contre
une hache, effectue un travail utile,
mais, du point de vue du mode de
production capitaliste il n’effectue pas
un travail productif, c’est-à-dire un
travail valorisant le capital générateur
de plus-value (3). De même pour un
enseignant, qui réalise un travail
utile, former la prochaine génération de
travailleurs salariés-exploités, mais ce
travail n’est pas productif – il ne
produit pas de plus-value. L’enseignant,
l’infirmière, le secrétaire sont des
travailleurs salariés socialement utiles
mais non producteurs de plus-value. Leur
salaire origine du
surtravail spolié aux prolétaires
productifs.
Ainsi, l’industrie
de l’armement produit des biens qui ne
sont pas des marchandises parce que ces
produits ne contribuent en rien à la
reproduction du capital. Ces biens – ces
« valeurs » ne servent pas à valoriser
le capital, d’où ce secteur industriel
est considéré comme parasitaire, non
productif, vivant au crochet du travail
salarié productif. Au contraire,
l’industrie militaire absorbe et détruit
de la valeur marchande (valeur
d’échange) et contribue à approfondir la
crise économique systémique. Si la
classe capitaliste mondiale maintient un
important dispositif militaire
parasitaire, ce n’est pas pour le
plaisir de faire la guerre, ou pour se
distraire, ou pour faire des profits,
profits qu’elle spolie aux autres
secteurs industriels. C’est que la
classe capitaliste parasitaire n’a pas
d’autres choix en prévision du jour où
ses concurrents monopolistiques
multinationaux tenteront de s’emparer de
ses espaces d’extraction des ressources,
de ses marchés, ou de ses zones
d’exploitation de la plus-value. Elle
devra alors les terroriser grâce à son
infrastructure militaire. En prévision
du jour également où la classe
prolétarienne paupérisée tentera de
secouer le joug de son aliénation en
quête d’émancipation. Il faudra bien,
ces jours pas si lointains, que le plein
poids de la loi bourgeoise, de la
mitraille et de la répression étatique
capitaliste s’abattent sur le dos de
cette classe en révolte.
Un évènement
historique gigantesque
Au cours des années
1990, un phénomène capital s’est produit
à l’échelle internationale avec l’entrée
sur le marché mondial concurrentiel de
la grande bourgeoisie chinoise,
indienne, et de celle de l’ancien bloc
soviétique, ce qui a conduit à doubler
en quelques années la force de travail
en concurrence sur le marché du travail
salarié (4). En termes d’économie
politique et en termes de lutte de la
classe prolétarienne, cet évènement fut
le plus important depuis la nuit des
temps. Pourtant, peu d’analystes en ont
apprécié l’incroyable portée. Par cette
expansion des moyens de production, sans
commune dimension dans l’histoire du
mode de production du
capital, l’impérialisme complétait
l’aménagement de la totalité des
territoires et des forces productives
dans le monde et assurait leur
incorporation aux rapports de production
capitalistes hégémoniques. Par cet
évènement incommensurable,
l’impérialisme terminait sa phase
d‘expansion (un siècle après le
pronostique des bolchéviques) et
l’impérialisme ne pouvait alors
qu’amorcer sa phase déclinante n’ayant
plus aucune « terre nouvelle » (sic),
plus aucune nouvelle force de travail à
spolier pour valoriser le capital
déprécié (5). Le mode de production
capitaliste n’a pas fini d’en ressentir
les effets qui mèneront certainement à
sa destruction.
Cet évènement est
la raison fondamentale pour laquelle le
début du XXIe siècle est une
période marquée par le déclin économique
et politique, et, conséquemment la
décadence sociologique et idéologique du
capitalisme. Marquer aussi par un grand
pessimisme traumatique qui voit surgir
en Occident des théories fumeuses
telles : « La fin de la classe
ouvrière ; la mort du Marxisme ;
l’apogée des luttes de libération
nationale et anti-impérialistes
bourgeoises (sic) ; l’émergence d’une
soi-disant classe moyenne ;
l’embourgeoisement de l’aristocratie
ouvrière stipendiée (sic) ; l’émergence
d’une nouvelle gauche démocratique,
citoyenne et républicaine (sic) ; les
théories complotistes et mystiques de
fin du monde civilisé ; la guerre des
civilisations ; la fin de l’histoire »
et autres fadaises idéalistes reflets du
déclin de la classe bourgeoise
occidentale devant la montée en
puissance du capital monopoliste
multinational venu d’Orient et la
croissance du contingent oriental et du
contingent africain du prolétariat
international.
Cette croissance de
la classe prolétarienne s’est produite
en très peu de temps. Si la montée en
puissance de l’impérialisme
américano-atlantique a nécessité deux
guerres mondiales et presque un siècle
d’expansion (1890 – 1975), l’entrée en
scène de la dernière phase de
l’impérialisme corporatistes-capitaliste
n’aura nécessité qu’une cinquantaine
d’années (1975 – 2020) et une guerre
mondiale (à venir !) À l’évidence,
l’histoire du mode de production
capitaliste s’accélère. On peut
anticiper qu’en 2020 environ, la Chine
aura remplacé la première puissance
impérialiste mondiale (USA) et que son
déclin sera déjà amorcé au milieu d’une
crise économique, systémique et
permanente, et parmi des guerres
régionales en cascades, jusqu’à et y
compris une possible troisième guerre
mondiale catastrophique. Mais avant
d’aborder ces questions, examinons les
données en ce qui concerne les effectifs
du prolétariat international.
L’expansion de la
classe prolétarienne dans le monde
« Ces jalons
posés nous pouvons maintenant voir ce
que représente au niveau mondial le
prolétariat dans son ensemble, le
prolétariat salarié (en soustrayant les
chômeurs) et le prolétariat créateur de
valeur (ce qui est plus compliqué, les
statistiques mondiales à ce sujet étant
difficiles à obtenir). Par élimination
nous allons essayer de donner une vision
plus large que les statistiques du
Bureau international du Travail (BIT) et
de l’Organisation internationale du
Travail (OIT), et pour la France du
Tableau de l’économie française de
l’INSEE qui est plus précis »
atteste Gérard Bad (6). Mais attention,
ces différents documents ne tiennent pas
compte du fait que, selon l’OCDE, plus
de la moitié de la population active
mondiale travaille au noir (le travail
au noir – clandestin – est source de
plus-value absolue). Les États bourgeois
complices de l’évasion fiscale de leurs
patrons milliardaires et des
multinationales monopolistes sont
grandement préoccupés par l’évasion
fiscale des petits salariés, les
serveuses de restaurants et les
journaliers. Prenez note toutefois, que
nous retrouvons dans ces
emplois sous-payés – non déclarés – une
importante contre-tendance à la baisse
du taux de profit à laquelle il faut
ajouter les 168 millions d’enfants
asservis et comptabilisés dans le monde.
Également, il ne faut pas oublier que
l’agriculture est le premier pourvoyeur
d’emplois, soit 40 % de la population
active mondiale classés « travailleurs
autonomes » (sic). Il y a forcément dans
ces 40 % d’exploités du servage agraire
une part importante de travailleurs
agricoles qu’il faudrait normalement
ajouter aux statistiques du prolétariat
mondial.
Les données de
l’OIT permettent d’estimée le salariat à
l’échelle mondiale. Dans les zones
« avancées » il a progressé d’environ
20 % entre 1992 et 2008, et il stagne
depuis l’intensification de la crise
systémique du capitalisme. Dans les
zones « émergentes », il a augmenté de
près de 80 % sur la même période
(graphique 1). On retrouve des
données analogues, mais encore plus
marquées, pour l’emploi dans l’industrie
manufacturière. Entre 1980 et 2005, la
main-d’œuvre industrielle (productrice
de plus-value) a augmenté de 120 % dans
les régions « émergentes » et diminuées
de 19 % dans les régions dites
« avancées » (7).
Le même constat
ressort d’une étude récente du FMI qui
calcule la force de travail dans les
secteurs exportateurs de chaque pays. On
obtient une estimation de la force de
travail mondialisée, celle qui est
intégrée à la chaine de production de
valeurs (capital productif et non
parasitaire de laquelle il faudrait
exclure les travailleurs de l’industrie
de l’armement ce qui pénaliseraient
encore davantage les pays « avancés »).
La divergence est encore plus marquante
: entre 1990 et 2010, la force de
travail globale, ainsi calculée, a
augmenté de 190 % dans les zones
« émergentes », mais de seulement 46 %
dans les régions développées (graphique
2). Il faut toutefois convenir d’une
différenciation qualitative entre ces
salariés. Si dans les zones
« émergentes » ces salariés s’ajoutent
aux forces productives industrielles et
manufacturières génératrices de
plus-value (même si ce n’est que pour
des tâches d’assemblage), dans les zones
développées les salariés à haute
productivité, produisant des
marchandises de haute qualité,
s’additionnent aux travailleurs
tertiaires des services de proximité et
ceux des services parasitaires (petits
boulots précaires, temporaires et mal
payés, dans la restauration,
l’hôtellerie, le transport,
l’alimentation, l’entretien et les
services de sécurité). Présentement les
multinationales du capital « émergent »
déploient des efforts pour hausser la
productivité du travail salarié et pour
assurer la montée en gamme de leur
production et de leur
consommation. Elles refont en somme, en
accéléré, le parcours qu’elles ont
fait du temps de leur développement en
régions capitalistes « avancées ».
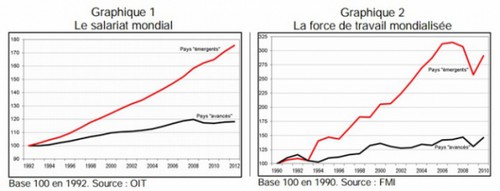
La tendance
inéluctable à la globalisation du mode
de production (la phase impérialiste du
mode de production capitaliste comme
l’esclavagisme et le féodalisme en
vécurent auparavant) conduit donc à la
formation d’un capital mondial, d’où
l’importance des circuits bancaires de
transferts du capital financier appelés
« paradis – Panamas – fiscaux » (8) –; à
la consolidation d’un marché mondial,
d’où la signature de multiples traités
de libre-échange (9), et, conséquemment,
à l’expansion d’un prolétariat précarisé
et mondialisé dont la croissance se fait
principalement dans les régions dites
« émergentes ». Ce processus
s’accompagne d’une tendance à la
salarisation et à l’urbanisation de la
force de travail dans le monde entier,
ce qui comprend la paysannerie chinoise,
indienne et africaine, peu à peu
arrachée à leurs terres et à leurs
villages et concentrée dans des bidons
villes délabrés, contexte urbanisé de
leur aliénation de salarié. Ce
qu’atteste le taux de salarié (la
proportion de salariés dans l’emploi)
qui augmente de manière constante,
passant de 33 % à 42 % mondialement au
cours des 20 dernières années (graphique
3). L’impérialisme moderne, sous le mode
de production capitaliste, est bien
caractérisé par la mondialisation des
rapports de production hégémoniques
capitalistes.
Graphique 3: Taux de
salarisation dans les pays « émergents »

La dynamique de
l’emploi dans le monde, illustré par le
graphique 4, peut être résumée ainsi :
Entre 1992 et 2012, quasi-stabilité ou
faible progression de l’emploi dans les
zones capitalistes « avancées » et
augmentation dans les régions
capitalistes dites « émergentes » :
+40%, comprenant un salariat en
croissance (salariat : +76 %, autres
modes d’emploi : +23 %).
Graphique 4
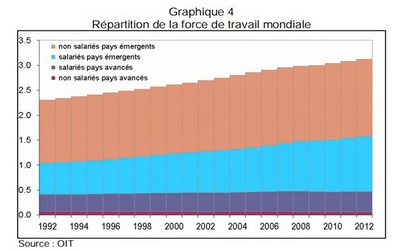
Pour l’année 2012,
les données de l’OIT conduisent à la
répartition suivante de l’emploi mondial
en milliards d’individus :
|
Emplois
dans les zones «avancées»
|
0,47
|
|
Emplois
salariés dans les zones
«émergentes»
|
1,11
|
|
Autres
emplois dans les zones
«émergentes»
|
1,55
|
|
Emploi
mondial total
|
3,13
|
La classe ouvrière
mondiale est très segmentée par
catégories, par revenus et par régions
géographiques, en raison d’écarts de
salaires considérables, et d’une
mobilité restreinte, malgré les
multiples efforts que déploie le capital
pour la poussée sur les sentiers des
réfugiés et sur les chemins de l’exil
forcé afin de la soumettre aux nouvelles
conditions d’exploitation international
du capital. Les capitaux quant à eux ont
obtenu une liberté de circulation à peu
près totale grâce d’une part aux
multiples traités et accords de
libre-échange, et d’autre part, grâce à
une vague sans précédent de fusions,
d’OPA et d’agrégation monopolistique des
entreprises capitalistes que nous avons
illustrées dans les chapitres
précédents (10). C’est le propre des
fusions-acquisitions qui concentrent et
centralisent le capital de restaurer
pour un temps le taux de profit moyen en
éliminant une pléthore de capitaux non
performants (les concurrents les plus
faibles). C’est ce qui s’est passé en
2008, quand les fusions-acquisitions,
OPA et autres malversations du capital
atteignirent 1 600 milliards de dollars
US en Europe et 1 800 milliards dollars
aux États-Unis. Il en résulta une baisse
relative du nombre de travailleurs, les
salariés n’étant après tout que la forme
variable du capital (Cv). Selon une
étude du Bureau international du Travail
(BIT), la croissance économique mondiale
en 2007 a été de 5,2 %, tandis que celle
du nombre de travailleurs n’a été que de
1,6 %, la différence s’expliquant par
l’inflation monétaire et par les progrès
en matière de productivité (étude citée
dans Le Figaro du 24 janvier 2008).
Depuis le début de 2014, il y a une
nouvelle frénésie de
fusions-acquisitions dans le monde,
c’est-à-dire une nouvelle vague de
liquidation d’une masse de capitaux
constants (Cc) – morts – et de
travailleurs vivants – capital variable
– (Cv) en excès dans le système de
production et d’échanges.
Dans ces
conditions, la
mondialisation-globalisation de
l’économie requiert de mettre
virtuellement en concurrence
internationale les travailleurs de tous
les pays, mondialisant de ce fait la
lutte de résistance du mouvement
prolétarien. Cette pression
concurrentielle s’exerce autant sur les
salariés des pays « avancés » que sur
ceux des pays « émergents » concurrents
et se traduit par une baisse
tendancielle de la part des salaires
dans le revenu mondial global
(Graphiques 5 et 6). Cette figure
démontre que le capital variable – le
capital vivant, unique source de
plus-value – prend encore moins
d’importance dans la composition du
capital par rapport au capital constant
– mort – non générateur de plus-value.
Preuve s’il en était besoin que le mode
de production capitaliste creuse sa
propre tombe. Pire, la prochaine étape
dans la négociation des accords de
libre-échange internationaux visera à
obtenir une plus grande mobilité –
continentale d’abord, et internationale
ensuite – du prolétariat (du capital
variable) afin d’accroitre la
concurrence salariale et de réduire
encore plus son importance relative, ce
que l’Union européenne a déjà accompli
sur le continent européen, prenant ainsi
une longueur d’avance sur les anciennes
puissances impérialistes concurrentes
(USA, Japon, Canada, Australie, Russie)
mais déjà en retard sur les nouvelles
puissances émergentes qui constituent
des marchés unifiés de grandes
importances (Chine 1,3 milliard de
consommateurs et 800 millions de
salariés éventuels et l’Inde, 1,4
milliard de consommateurs et 850
millions de salariés virtuels). Tout
ceci donne une idée du manque de vision
des bobos altermondialistes, des
réformistes et des gauchistes
petits-bourgeois qui s’offusquent de la
tombée des barrières tarifaires et
législatives (droit du commerce, droit
du travail, droit social, droit fiscal,
judiciarisation de la répression,
militarisation de l’économie, etc.)
plaçant tous les moyens de production et
toutes les forces productives
« nationales » en concurrence
internationale. Pas plus qu’il n’est
opportun de dénoncer les ouragans et les
typhons, il n’est pertinent de quémander
des allègements aux conséquences de
l’internationalisation de l’impérialisme
globalisé qui ne peut qu’avancer,
pousser par ses propres contradictions
inexorables. Il y a longtemps que le
prolétariat affirme que les forces
productives ne peuvent s’épanouir à
l’intérieur des rapports de production
bourgeois trop étroits. Il faudra
simplement mettre fin à ce mode de
production moribond qui ne peut et ne
pourra jamais fonctionner de manière
différente qu’il ne fonctionne
présentement.
Enfin, les
graphiques 5 et 6 marquent le Te Deum de
ce mode de production basé sur la
valorisation de la plus-value et la
reproduction élargie du capital. Alors
que la masse totale des salariés
prolétarisés augmente constamment, la
part des salaires dans le revenu mondial
diminue radicalement (11). Gardant en
tête le principe qu’une marchandise se
vend à son cout de production (ou de
reproduction élargie dans le cas de la
marchandise force de travail) cette
donnée statistique signifie que depuis
les années 1970 environ, le moment de
l’inversion de la courbe ascendante du
mode de production capitaliste
globalisé, la force de travail se vend
et s’achète en moyenne en dessous de son
cout de reproduction social. Voilà le
post mortem des théories opportunistes à
propos de l’aristocratie ouvrière
embourgeoisée et stipendiée ; des
classes moyennes lénifiantes ; de la
mort de la classe prolétarienne et de la
théorie du dépassement du capitalisme
(sic). Voici l’acte final de la tragédie
capitaliste mondialisée. Quand un mode
de production ne permet plus aux forces
productives qu’il renferme de se
déployer et de faire fructifier les
moyens de production, mais qu’au
contraire il les entraine vers leur
dévalorisation et leur autodestruction,
alors, ce mode de production doit
disparaitre, sublimer par un nouveau
mode de production plus performant. Ce
graphique résume à lui seul les forces
en jeux dans la révolution prolétarienne
à venir.
Graphique 5 : Part
des salaires dans le revenu mondial
1970-2010
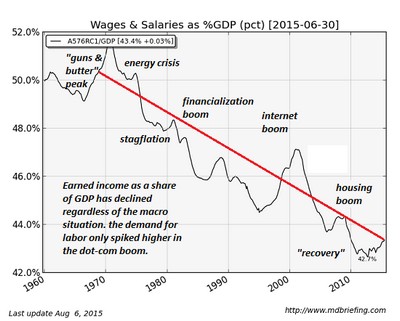
En % du PIB.
Calculs à partir de Stockhammer, 2013
(12).
Graphique 6

Références
Moyenne des pays
suivants : Allemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
États-Unis, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède. Argentine,
Brésil, Chili, Chine, Costa Rica, Kenya,
Mexique, Namibie, Oman, Panama, Pérou,
Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud,
Thaïlande, Turquie.
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

