Les 7 du Québec
Salariés congédiés = profits plus
élevés !?...
Robert Bibeau
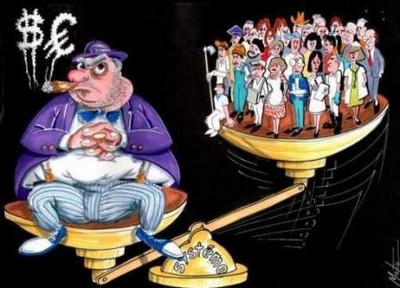
Mercredi 13 septembre 2017 Le paradoxe des
salariés congédiés et des profits plus
élevés.
Récemment, notre
webmagazine indiquait qu’année après
année les milliardaires du monde entier
(notamment ceux du CAC 40 en France)
empochent des profits mirobolants
pendant que le chômage sévit lourdement
(1). En 2016, dans le monde, 1 700
milliards de dollars de dividendes ont
été versés aux actionnaires. En 2016,
55,7 milliards d’euros ont été
distribués en dividendes aux
actionnaires du CAC 40. À contrechamp,
en deux ans, en France, 407 usines ont
été fermées (2014-2015), hécatombe qui
rempile sur la destruction de 1,4
million d’emplois en 25 ans dans
l’hexagone. Aujourd’hui, la France
compte 6 612 700 chômeurs et
travailleurs
occasionnels précarisés, auxquels il
faut ajouter 4 800 000 chômeurs
invisibles qui ne sont pas comptabilisés
dans les statistiques officielles (2).
La situation est analogue dans la
plupart des pays industrialisés
dominants.
Paradoxal puisque les profits proviennent de la
plus-value, la portion non payée du
travail salarié. Moins de travail
salarié aurait généré plus de plus-value
et des profits plus élevés, comment
l’expliquer/b> ? Comment une production
marchande déclinante peut-elle générer
des profits en croissance ? Comment
décrypter ce paradoxe ?
Hausse de
productivité.
Si moins de temps
de travail salarié a permis de produire
globalement plus de plus-value (valeur
ajoutée) et de générer des profits
accrus au total, c’est que l’intensité
du travail a augmenté. Chaque prolétaire
a produit en moyenne davantage d’items
ce qui fait que moins de salaires
engagés (capital variable ou Cv) ont
généré plus de valeur ajoutée et de
valeur marchande commercialisée totale,
chaque item valant moins d’argent
cependant. En ce qui concerne la
productivité, la France se situe dans le
peloton de tête au niveau mondial. Avec
des salariés qui rapportent 54,8
€/heure, la France est loin devant la
moyenne européenne de 43,9 €/heure…et
même devant l’Allemagne à 53,4€/heure.
Le Canada se compare aux valeurs
supérieures des pays européens (3).
Cependant, ces
hausses de productivités ont un cout.
D’abord, cette exploitation plus
intensive de la main-d’œuvre entraine
des couts plus élevés de reproduction
de la force de travail ce que
confirme la comparaison des salaires
entre les pays de l’Union européenne.
Dans l’UE, le cout du travail était, en
2011, pour les entreprises de plus de 10
salariés, de 23,1 euros de l’heure, avec
de fortes disparités : de 3,5 € en
Bulgarie à 44,2 euros en Norvège. Avec
34,2 euros de l’heure en moyenne, la
France est dans le groupe de pays au
« cout » du travail salarié élevé (4).
Donc, une productivité plus élevée
entraine des salaires plus élevés pour
chaque ouvrier engagé quoique moins
élevé par unité de marchandise
commercialisée. Ce que Marx avait
subodoré en affirmant que ce sont les
productivités faibles qui entrainent des
salaires plus élevés par unité de
marchandise commercialisée. Suzanne
Berger donne l’exemple du fabricant
de lunette italien « Luxottica ».
Elle compare les frais de production de
trois usines (…) dans différents pays.
Elle remarque que le cout de deux verres
dans une usine chinoise est de 2,63
dollars, en Irlande de l’ordre de 2,49
dollars alors qu’en Italie avec un
salariat plus couteux, le cout des
verres n’est que de 1,20 dollar (5).
Conclusion, dans
cet exemple c’est en Chine que les couts
salariaux sont plus élevés comparer aux
salaires pratiqués en France, en Irlande
et en Italie. À la lumière de ces
révélations doit-on croire les
théoriciens de la délocalisation
industrielle, de l’Europe et d’Amérique
du Nord, vers les pays « émergents » aux
salaires apparemment plus élevés ? Oui,
mais en y apportant un complément
d’information. Ces délocalisations ont
lieu parce que les entreprises
impérialistes occidentales qui
délocalisent transfèrent avec elles
leurs technologies de pointe à forte
productivité. Contrairement à
l’exemple Luxottica, généralement,
l’ouvrier chinois ou indien formé,
mécanisé, et mal payé est, pour un temps
du moins, aussi productif que l’ouvrier
occidental, le temps qu’il se mette lui
aussi à réclamer des salaires lui
permettant d’assurer la reproduction
élargie de sa force de travail bien
formée et surexploitée. Pas surprenant
que la Chine soit confrontée à
l’agitation ouvrière et aux grèves.
La part des salaires
dans la valeur des marchandises.
Incidemment, un
économiste comme Thomas Piketty
pourrait rétorquer que la part du
travail salarié dans le prix d’un
produit fini est très faible. Dans
l’automobile, la part du cout des
salaires dans le prix d’un véhicule pour
l’entreprise finale qui l’assemble et le
commercialise est de 10% dit-on. Cette
statistique est incomplète. C’est comme
si on ne calculait, pour fixer le prix
de vente d’un véhicule, que les couts du
travail de finition oubliant les
intrants et le travail en amont. Ainsi,
le prix de chaque composant automobile
inclut une part de salaire et une part
de moyens de production, comprenant
l’amortissement de la machinerie de plus
en plus sophistiquée et couteuse, donc
gorgée de salaires ouvriers. Pour
calculer la part des salaires dans le
prix final d’un véhicule il faut cumuler
les salaires des mineurs, des cheminots,
des fondeurs, des débardeurs, des
soudeurs, des lamineurs jusqu’aux
assembleurs, et tous les autres salariés
qui participent à la transformation des
intrants, y compris la fabrication des
machines-outils robotisées qui ne font
que transférer leur valeur (capital
variable et capital constant) dans
chaque unité de marchandise produite et
commercialisée.
Incidemment, une
hausse de productivité dans une
quelconque étape du processus de
fabrication se répercute dans l’ensemble
de la chaine de production et bénéficie
à tous les capitalistes de la chaine de
production. C’est cela la « solidarité »
capitaliste qui pourtant ne parvient pas
à tuer la concurrence entre les chacals
de la finance.
Surproduction et
accumulation des invendus.
Cependant, le
propre d’une innovation technologique
est de se répandre dans l’ensemble d’un
secteur industriel et/ou commercial si
bien que cette productivité plus élevée
devient bientôt la norme universalisée.
Un peu comme la plus performante des
ouvrières du textile, rémunérée à la
pièce, fait monter la norme moyenne dans
l’ensemble de l’atelier. Ces hausses de
productivité recèlent une
intensification de l’exploitation du
travail salarié et les augmentations de
profits s’expliquent par une diminution
des couts de production. Au bout du
processus, le salaire moyen stagne alors
que les effectifs salariés diminuent
compensés par une machinerie
sophistiquée – robotisée – mais couteuse
en salaire cumulé cristallisé. La
production totale augmente (en valeur)
alors que le cout de revient unitaire
diminue et que la composition organique
du capital augmente (du temps de travail
cristallisé), les profits augmentent
globalement, mais pas nécessairement le
taux de profit moyen puisque cet afflue
soudain de marchandises – moins
coûteuses -, déversées sur un marché
atrophié (conséquence d’une masse
salariale anémiée) impose une pression
supplémentaire à la baisse sur les prix
et les taux de profits. À la limite, le
capital ne parvient plus à se
« réaliser » dirait Marx, à se
matérialiser en plus-value et nouveau
capital productif susceptible d’être
valoriser. C’est l’ensemble du cycle
capitalistique qui se trouve enrayé,
assurance absolue d’une prochaine crise
économique systémique qui serait en
cours selon nombre d’économistes (6).
Et aux banquiers
vous y avez pensé?
De plus, ces
hausses de productivité entrainant
momentanément une hausse de
profitabilité ne sont valables que pour
les entreprises industrielles, du
transport et pour les firmes
commerciales productrices de plus-value
(valeur ajoutée). Les fonds de
placement, les banques, les assurances
et autres requins de la finance n’ont
accès à cette masse de profits amplifiée
que de manière détournée, via les
marchés boursiers comme nous le verront
dans la suite de ce papier. Évidemment,
si les financières peuvent réduire leur
masse salariale, voilà autant d’argent
épargné pour rétribuer le capital
emprunté d’où les congédiements massifs
dans les secteurs tertiaire et
quaternaire bancaires. Cependant, depuis
quelque temps, l’intérêt sur épargnes
étant décevant, les grandes
multinationales industrielles et
commerciales font des efforts pour
s’autofinancer et s’affranchir de
l’emprise des banksteurs spéculateurs ce
qui rend l’accaparement de la plus-value
industrielle de plus en plus ardue pour
les boursicoteurs agités sur les
parquets boursiers.
Tesla, la grenouille
plus grosse que GM !
Banquiers et
financiers ne baissent pas les bras pour
autant et développent de nouveaux
« produits financiers » afin de
participer eux aussi à la curée des
profits débridés. En avril 2017 l’Agence
France Presse (AFP) a publié un
communiqué sur la Société automobile
Tesla de Californie
« Tesla a atteint 51,6 milliards de
dollars US (48.7 milliards d’euros) de
capitalisation boursière. Ce niveau lui
a permis de dépasser le premier
constructeur américain General Motors
(GM) valorisé à 50,2 milliards de
dollars. Si les investisseurs parient
sur les nouvelles technologies, cela ne
reflète pas le rapport de force entre
les deux groupes. En 2016, le
Californien a produit 84 000 véhicules
pour un chiffre d’affaires de 7
milliards de dollars, contre 10 millions
de voitures pour GM et plus de 166
milliards de dollars de revenus. La part
de marché de l’entreprise de Détroit est
de 17,3% contre 0,2% pour Tesla. » (7)
Sachant que pour
produire de la plus-value et des profits
il faut produire de la valeur. Sachant
que Tesla, capitaliser
(endettée) à 7 fois la valeur de ses
ventes, a produit pour 7 milliards de
dollars de valeur et que GM, capitaliser
(endettée) à 33% de la valeur de ses
ventes, a produit pour 166 milliards de
valeurs quelle entreprise risque de
rapporter le plus de dividendes à ses
actionnaires ? Il est évidemment
possible que GM, qui a produit beaucoup
plus de plus-value, distribue moins de
dividendes à ses actionnaires, la grande
part de ses bénéfices servant à
rembourser sa dette, ou encore, que la
firme de Détroit préfère conserver des
liquidités en prévision
d’investissements futurs ou pour parer à
une OPA inamicale. Il est cependant
évident que Tesla ne pourra
assurer un dividende intéressant à
partir de ses ventes même s’ils sont en
forte croissance. Ce constat étant
établi il faut savoir que le
rendement n’est qu’un calcul
mathématique allant comme suit : montant
du dividende, divisé par le niveau du
cours de l’action au moment du
versement. Le montant du dividende et
le cours de l’action influencent donc le
rendement. Le dividende peut être
fort, et le cours être faible. Si le
cours d’un titre chute rapidement, et si
le dividende reste fixe, le rendement
s’envolera alors même que l’action sera
à liquider. Prenons l’exemple d’une
société distribuant un dividende de 3
euros. Si l’action cote 96 euros,
le rendement sera de 3,125%, soit
dans la moyenne. Mais si l’action chute
fortement à 57 euros à cause de rumeurs
sur l’endettement trop important, le
rendement s’envolera à 5,26%.
L’entreprise n’y aura toutefois pas
gagné en attractivité au contraire et il
est à parier que les actionnaires
chercheront à se départir du titre
faisant chuter son cours. Comment
expliquer ce paradoxe boursier où une
valeur attractive s’effondre à cause de
son attractivité ? Et surtout comment
comprendre que des investisseurs
participent à ce coup de poker financier
risqué ?
La Pyramide de Ponzi
financière.
Imaginons un grand
fonds d’investissement multinational,
administrant les fonds de retraite, les
assurances et les épargnes de millions
d’individus dont les profits mirobolants
des CAC 40 que nous avons vus exposés
précédemment. Cet argent, qui n’est pas
encore du capital productif, du moins
tant qu’il n’a pas trouvé à se placer
pour se valoriser à travers l’actif
financier d’entreprises productives. Ce
fonds de placement gorgé d’argent lance
donc une opération d’investissement en
direction de Tesla, une
entreprise prospère, versant un bon
dividende, ayant des projets d’expansion
et bénéficiant d’une bonne réputation de
gestion. Au début, les actions sont
acquises à un prix raisonnable, mais
plus l’investissement s’accumule plus le
prix de l’action grimpe. L’opération
savamment publicisée attire l’attention
de petits spéculateurs ayant eux aussi
des profits en jachère boursière à
valoriser, quand ce ne sont pas des
investisseurs qui iront jusqu’à
emprunter pour acheter de la valeur
boursière fictive. Le prix de l’action –
indice de sa valeur – du groupe Tesla
grimpe en flèche alors qu’aucune valeur
ni aucune plus-value n’est produite.
Cette activité boursière spéculative
fonctionne sur le principe de la
Pyramide de Ponzi, chaque nouvel
investisseur garantissant la valeur des
actifs des investisseurs précédents sous
condition du recrutement de
l’investisseur subséquent jusqu’au
rapport financier suivant où tous se
rendent compte que l’action a grimpé,
mais que les rendements sont décevants
ce qui ne peut aller autrement étant
donné le taux d’endettement (700% de la
valeur des ventes). S’ensuit un vent de
panique où chacun tente de se départir
de ses actifs au plus vite alors que
personne ne veut acheter des actions
plombées d’où l’effondrement de la
valeur que les premiers investisseurs
qui se sont retirés du marché bien avant
le dépôt du bilan peuvent racheter à
vils prix sachant que l’entreprise peut
rebondir sous un nouveau président. Ou
alors, le grand fonds de placement range
ses billes et cherche un nouveau
placement spéculatif tout aussi lucratif
alors que nombre d’investisseurs
comptabilisent leurs pertes comme la
Caisse de Dépôt du Québec qui décaissa
40 milliards de dollars en 2008 suite à
l’arnaque des « subprimes » aux
États-Unis. Ainsi, on apprenait en aout
2017 que la firme Amazon, plateforme
numérique de services de distribution en
ligne valait soudainement plus de 500
milliards de dollars US. Une
entreprise qui produit bien peu de
plus-value pourtant, mais qui sait
capter la plus-value produite par les
compagnies productrices lors du
processus de commercialisation des
marchandises. Tant que le crédit est
florissant, l’action des marchands est
garantie…après ce sera à vos risques et
périls.
La concentration
inévitable du capital.
C’est ainsi que
tout naturellement l’argent s’accumule
et se concentre entre quelques mains
(2000 milliardaires dans le monde) au
sommet de la pyramide bancale du
capital, non pas par mauvaise foi de
capitalistes inconscients, mais par le
fonctionnement mécanique du mode de
production capitaliste en phase
impérialiste. Le capitaliste financier
qui n’appliquerait pas ces méthodes de
gestion pour valoriser l’argent dont il
a l’administration et en faire du
capital « rentable » serait écarter de
l’administration des fonds de placement.
Les altermondialistes et les gauchistes
qui réclament une plus juste
distribution de la richesse sociale sont
les nouveaux prêtres qui supplient le
ciel de venir au secours des naufragés
salariés.
L’État fétiche.
Face à ce trauma,
cette iniquité sociale, la go-gauche
réformiste, pleurniche et réclame à cor
et à cri l’intervention de l’État de
justice (sic). Chaque secte gauchiste,
altermondialiste ou réformiste, a sa
solution étatique pour mettre fin à ces
malversations des riches. Nombreux sont
ceux qui cherchent des solutions
corporatistes dans le discours des
polichinelles politiques et des
critiques contre le capitalisme que
Mélenchon leur sert à profusion.
Sachez qu’Hitler, avant sa
nomination en tant que chancelier
allemand, déclamait des diatribes
virulentes contre les financiers
germaniques voraces et le Parti
national-socialiste présentait un
programme visant à mettre au pas les
financiers trop gourmands. On sait ce
qu’il en fut une fois élu. Tous les
politiciens bourgeois de gauche comme de
droite font de telles promesses, y
compris Donald Trump.
La résistance du
prolétariat.
Le prolétariat
mondial qui a compris qu’aucune solution
ne viendra des dieux de la peste du
capital, ni de leur état-major
politique, répudie ces mascarades
électorales opposant la gauche et la
droite bourgeoises. Ensuite, le
prolétariat poursuit sa guerre de classe
là où ça compte vraiment, sur les lieux
de travail et dans les quartiers. Il ne
compte que sur lui-même pour défendre
ses conditions de vie et de travail. Et
c’est très bien ainsi. Espérons que les
manifestations de la colère en septembre
à Paris donneront lieu à des actions
plus conséquentes et convaincantes que
des parades syndicales dans les rues de
France.
NOTES
Reçu de Robert Bibeau pour
publication
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Le dossier
Monde
Le dossier
Monde
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

