Brève histoire du
précurseur de l’indépendance d’Haïti
Toussaint Louverture, la dignité
révoltée
Salim Lamrani
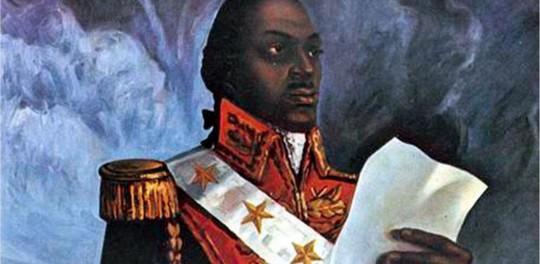
Portrait
libre de Toussaint Louverture. DR
Jeudi 13 juin 2019
Source :
https://www.humanite.fr/toussaint-louverture-la-dignite-revoltee-673220
TROISIÈME PARTIE
7.
La
trahison de Napoléon Bonaparte
Face à la ténacité des habitants,
accablé par le climat et les maladies,
le général Leclerc proposa la fin des
hostilités[1].
Pour sauver les vies humaines, Toussaint
accepta le pacte à condition qu’il
s’agît d’une paix digne et honorable.
« L’intérêt public exigeait que je fisse
de grands sacrifices », écrivit-il dans
ses mémoires[2].
L’accord fut conclu sur les bases
suivantes : liberté pour tous les
citoyens de l’île et conservation de
leur grade et fonction pour tous les
officiers civils et militaires. De son
côté, le leader noir conserverait son
état-major et choisirait son lieu de
résidence[3].
L’accord de paix fut conclu et Toussaint
Louverture décida de se retirer à Ennery[4].
Mais les promesses ne furent pas tenues.
Ainsi, les généraux Jean-Jacques
Dessalines et Charles Belair, qui
devaient conserver leurs commandements
respectifs à Saint-Marc et à l’Arcahaye,
furent démis de leurs fonctions[5].
Conscient de la popularité du leader de
Saint-Domingue, le général Leclerc
dépêcha une troupe de 500 soldats dans
le petit bourg où Toussaint Louverture
avait élu demeure, afin de le surveiller[6].
Ce dernier était lucide sur la situation
et n’était pas dupe du sort qui
l’attendait : « Le lendemain, je reçus
dans cette habitation la visite du
commandant d’Ennery, et je m’aperçus
fort bien que ce militaire, loin de me
rendre une visite d’honnêteté, n’était
venu chez moi que pour reconnaître ma
demeure et les avenues, afin d’avoir
plus de facilité de s’emparer de moi,
lorsqu’on lui en donnerait l’ordre[7] ».
Louverture subit des humiliations
quotidiennes de la part de l’armée
coloniale, qui se rendait sur ses
propriétés pour en détruire ses
récoltes. « Alors que le général Leclerc
[avait] donné sa parole d’honneur et
promis la protection du gouvernement
français », sa dignité était bafouée par
les représentants du Premier Consul.
Toussaint Louverture rappela ce
douloureux épisode :
Tous les
jours, je n’éprouvais que de nouveaux
pillages et de nouvelles vexations. Les
soldats qui se portaient chez moi
étaient en si grand nombre, que je
n’osais pas même les faire arrêter. En
vain, je portais mes plaintes au
commandant, je n’en recevais aucune
satisfaction. Je me déterminai enfin,
quoique le général Leclerc ne m’eût pas
fait l’honneur de répondre aux deux
premières lettres que je lui avais
écrites à ce sujet, à lui en écrire une
troisième. […] Je ne reçus pas plus de
réponse à celle-ci qu’aux précédentes[8].
Bonaparte
jugea alors que sa présence dans l’île
était trop dangereuse et décida de
procéder à son arrestation. Violant
l’accord conclu, le général Leclerc, sur
ordre de Consul, chargea le général
Brunet, commandant militaire de la zone
de Ennery, de l’opération. Le 7 juin
1802, ce dernier invita Toussaint
Louverture avec toute sa famille dans sa
demeure sous le prétexte d’évoquer des
différents problèmes rencontrés. Il
l’assura de ses meilleures dispositions
à son égard et vilipenda même les
« malheureux calomniateurs » qui
accusaient le leader noir de fomenter la
sédition. « Vos sentiments ne tendent
qu’à ramener l’ordre et la tranquillité
dans le quartier que vous habitez »,
écrivit Brunet dans la lettre. Le reste
de la missive mérite d’être citée dans
ses grandes lignes :
Nous avons,
mon cher général, des arrangements à
prendre ensemble qu’il est impossible de
traiter par lettres, mais qu’une
conférence d’une heure terminerait ; si
je n’étais pas excédé de travail, de
tracas minutieux, j’aurais été
aujourd’hui le porteur de ma réponse ;
mais ne pouvant ces jours-ci sortir,
faites-le vous-même ; si vous êtes
rétabli de votre indisposition, que ce
soit demain ; quand il s’agit de faire
le bien, on ne doit jamais le retarder.
Vous ne trouverez pas dans mon
habitation champêtre tous les agréments
que j’eusse désiré réunir pour vous y
recevoir ; mais vous y trouverez la
franchise d’un galant homme qui ne fait
d’autres vœux que pour la prospérité de
la colonie et votre bonheur personnel.
Si madame
Toussaint, dont je désire infiniment
faire la connaissance, voulait être du
voyage, je serai content. Si elle a
besoin de chevaux, je lui enverrai les
miens.
Je vous le
répète, général, jamais vous ne
trouverez d’ami plus sincère que moi. De
la confiance dans le capitaine-général,
de l’amitié pour tout ce qui est
subordonné et vous jouirez de la
tranquillité[9] ».
Accompagné de deux officiers, Toussaint
Louverture décida de se rendre chez le
général Brunet. A son arrivée, après les
salutations d’usage, il fut conduit dans
une chambre où l’attendait le
représentant bonapartiste. Ce dernier,
prétextant une urgence, quitta la pièce.
La suite fut contée dans les mémoires du
leader haïtien : « A peine était-il
sorti, qu’un aide-de-camp du général
Leclerc entra accompagné d’un très grand
nombre de grenadiers, qui
m’environnèrent, s’emparèrent de moi, me
garrotèrent comme un criminel et me
conduisirent à bord de la frégate la
Créole. Je réclamai la parole du
général Brunet et les promesses qu’il
m’avait faites, mais inutilement ; je ne
le revis plus[10] ».
Après avoir
arrêté Toussaint Louverture, le général
Brunet, le même qui signerait la
capitulation de Paris en 1814, fit subir
« les plus grandes vexations à sa
famille », procéda à son arrestation et
pilla la propriété avant d’y mettre le
feu. Le 11 juin 1802, en compagnie de
son épouse et de ses deux fils, il fut
embarqué à destination de Brest. Mais
loin de se résigner, il lança cet
avertissement prophétique : « En me
renversant, on n’a abattu à
Saint-Domingue que le tronc de l'arbre
de la liberté des noirs ; il repoussera
parce que les racines en sont profondes
et nombreuses[11] ».
8.
Dans les
geôles du Jura
A son arrivée en France en août 1802,
Toussaint Louverture resta en rade dans
le port de Brest pendant plus de deux
mois sans sortir du bateau. « Après un
pareil traitement, ne puis-je pas à
juste titre demander où sont les effets
des promesses qui me furent faites par
le général Leclerc sur sa parole
d’honneur, ainsi que la protection du
gouvernement français ? »,
s’interrogea-t-il[12].
« Sans doute je dois ce traitement à ma
couleur ; mais ma couleur… ma couleur
m’a-t-elle empêché de servir ma patrie
avec zèle et fidélité ? », souligna-t-il[13].
Il ajouta le propos suivant :
Etait-il
besoin d’employer cent carabiniers pour
arrêter ma femme et mes enfants sur
leurs propriétés, sans respect et sans
égard pour le sexe, l’âge et le rang ;
sans humanité et sans charité ?
Fallait-il faire feu sur les
habitations, sur ma famille, et faire
piller et saccager toutes mes
propriétés ? Non. Ma femme, mes enfants,
ma famille ne sont chargés d’aucune
responsabilité. Ils n’avaient aucun
compte à rendre au gouvernement ; on
n’avait pas même le droit de les faire
arrêter[14].
Toussaint
Louverture fut séparé de sa famille et
conduit, sans procès, au Fort de Joux
dans le Jura. « On m’a envoyé en France
nu comme un ver ; on a saisi mes
propriétés et mes papiers ; on a répandu
les calomnies les plus atroces sur mon
compte », écrivit-il avec amertume[15].
Confiné dans une cellule, Bonaparte
l’obligea à retirer son uniforme de
général pour revêtir l’uniforme de
reclus, humiliant ainsi le vénérable
combattant de 59 ans. Louverture ne
résista pas longtemps aux rigueurs de
l’hiver et à ses conditions de
détention. Le 7 avril 1803, il décéda de
maladie dans les geôles du château.
9.
Révolte du
peuple louverturiste et indépendance
d’Haïti
Le 20 mai
1802, malgré ses engagements, Bonaparte
publia le décret rétablissant
l’esclavage dans les colonies, devenant
ainsi le seul chef d’Etat de l’histoire
de France à avoir réduit à la servitude
ses propres citoyens. Il procéda
également à l’élimination minutieuse des
officiers fidèles au Précurseur. Le
peuple, loyal à l’héritage rebelle
laissé par Louverture, se souleva en
armes contre l’arbitraire napoléonien.
Les généraux Henri Christophe et
Jean-Jacques Dessalines reprirent le
maquis et déclenchèrent l’insurrection
dans toute l’île. L’armée coloniale,
assiégée de toutes parts par les
révolutionnaires, étouffée par la fièvre
jaune qui avait emporté le général
Leclerc le 2 novembre 1802, fut
contrainte de se retirer dans ses deux
derniers bastions à Port-au-Prince et au
Cap[16].
En octobre
1803, Dessalines, général en chef des
révolutionnaires, reconquit
Port-au-Prince. L’armée coloniale
dirigée par le général Rochambeau fut
obligée à se retirer au Cap. Assiégé une
nouvelle fois, privé de vivres,
Rochambeau dut capituler le 19 novembre
1803, suite à la bataille de Vertières,
près de Cap-Français. Il rentra en
France à la tête des quelque 10 000
survivants restants sur une troupe
totale de 45 000 soldats. Un mois et
demi plus tard, le 1er
janvier 1804, les révolutionnaires
proclamèrent l’indépendance d’Haïti et
portèrent le général Dessalines,
lieutenant de Toussaint, né esclave, à
la tête de la nation nouvelle[17].
Dans ses
mémoires, Napoléon Bonaparte reconnut
son erreur :
J’ai à me
reprocher une tentative sur cette
colonie lors du consulat ; c’était une
grande faute que de vouloir la soumettre
par la force ; je devais me contenter de
la gouverner par l’intermédiaire de
Toussaint. […] L’une des plus grandes
folies que j’ai faites et que je me
reproche a été d’envoyer une armée à
Saint-Domingue. J’aurais dû voir qu’il
était impossible de réussir dans le
projet que j’avais conçu. J’ai commis
une faute, et je suis coupable
d’imprévoyance, de ne pas avoir reconnu
l’indépendance de Saint-Domingue et le
gouvernement des hommes de couleur[18] ».
En 1825, la France du roi Louis-Philippe
reconnut l’indépendance de la République
d’Haïti, non sans l’avoir obligée à
payer la somme de 150 millions de francs
or pour indemniser les anciens colons
qui avaient exploité la terre et le
peuple de Saint-Domingue pendant des
générations[19].
L’abolitionniste Victor Shoelcher
dénonça cette extorsion avec éloquence :
« Imposer une indemnité à des esclaves
vainqueurs de leurs maîtres, c’est faire
acquitter à prix d’argent ce qu’ils ont
déjà payé de leur sang[20] ».
Haïti mit près d’un siècle à payer cette
rançon, au détriment de son propre
développement.
Aimé Césaire résuma l’héritage du
Premier des Noirs dans la lutte des
peuples pour leur émancipation :
Quand
Toussaint Louverture vint, ce fut pour
prendre à la lettre la déclaration des
droits de l’homme, ce fut pour montrer
qu’il n’y a pas de race paria ; qu’il
n’y a pas de pays marginal ; qu’il n’y a
pas de peuple d’exception. Ce fut pour
incarner et particulariser un principe ;
autant dire pour le vivifier. […]. Cela
lui assigne sa place, sa vraie place. Le
combat de Toussaint Louverture fut ce
combat pour la transformation du droit
formel en droit réel, le combat pour la
reconnaissance de l’homme et c’est
pourquoi il s’inscrit et inscrit la
révolte des esclaves noirs de
Saint-Domingue dans l’histoire de la
civilisation universelle[21].
Conclusion
Toussaint Louverture, guide moral du
peuple haïtien, s’éleva contre
l’oppression coloniale et raciale qui
frappait les siens. Partisan de la
concorde entre tous les habitants de
Saint-Domingue, il prit les armes pour
l’émancipation des opprimés. S’il se
montra implacable avec ses adversaires
au nom de la raison d’Etat, il combattit
l’esclavage au nom du principe universel
et inaliénable d’égalité entre tous les
hommes. Fédérant autour de lui les
exploités arrachés à leur terre natale
africaine, combattant les armées de
trois empires, il revendiqua le droit du
peuple noir à s’émanciper de
l’exploitation et à jouir d’une
meilleure destinée.
En brisant les chaînes du joug colonial
par la lutte armée et en fondant une
nation, Toussaint Louverture et le
peuple noir d’Haïti indiquèrent au reste
de l’Amérique latine la voie à suivre
pour mettre à un terme à la domination
européenne sur les terres du
Nouveau-Monde. A aucun autre moment de
l’histoire de l’humanité, des esclaves
avaient édifié une patrie.
« L’homme-nation », comme le qualifia
Alphonse de Lamartine, symbolise à ce
jour l’aspiration des opprimés à jouir
de leurs droits naturels et à vivre dans
la dignité.
Docteur ès
Etudes Ibériques et Latino-américaines
de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim
Lamrani est Maître de conférences à
l’Université de La Réunion, spécialiste
des relations entre Cuba et les
Etats-Unis.
Son
dernier ouvrage s’intitule Fidel
Castro, héros des déshérités, Paris,
Editions Estrella, 2016.
Préface d’Ignacio
Ramonet.
Contact :
lamranisalim@yahoo.fr ;
Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Page Facebook :
https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[2]
Toussaint Louverture,
Mémoires du Général Toussaint
Louverture, op. cit.,
p. 71.
[3]
Antoine Marie
Thérèse Métral & Isaac Toussaint
Louverture, Histoire de
l’expédition des Français à
Saint-Domingue, op. cit.,
p. 281-82.
[4]
Toussaint Louverture,
Mémoires du Général Toussaint
Louverture, op. cit.,
p.73.
[17]
Pierre Pluchon,
Haïti, république Caraïbe,
L’Ecole des Loisirs, 1974, p.
43-44.
[18]
Comte de Las Cases, Mémorial
de Sainte-Hélène, Paris,
Ernest Bourdin Editeur, 1842,
Tome Premier, p. 687.
[19]
Charles X, “Ordonnance du Roi”,
17 avril 1825 in Antoine
Marie Thérèse Métral & Isaac
Toussaint Louverture, op. cit.,
p. 341-42.
[20]
Victor Schoelcher,
Colonies étrangères et Haïti.
Résultats de l’émancipation
anglaise, Paris, Pagnerre
Editeurs, 1843, Tome second, p.
167.
[21]
Aimé Césaire, Cahier à d’un
retour à son pays natal,
(1947), Paris, Présence
africaine, 1983, p. 24.
 Le sommaire de Salim Lamrani
Le sommaire de Salim Lamrani
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

