Les 7 du Québec
Pourquoi la Seconde Guerre mondiale n’a
pas
provoqué la Révolution prolétarienne
internationale ?
Robert Bibeau
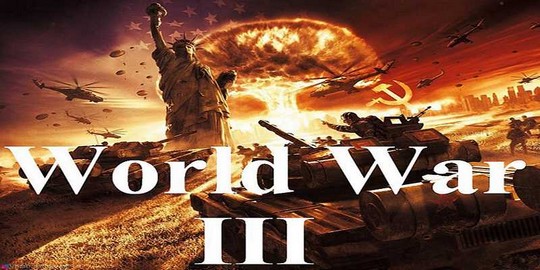
Mercredi 28 novembre 2018
Pourquoi ?
Nous avons
récemment publié un important texte du
groupe espagnol « Nuevo
Curso » qui pose une
question cruciale pour le mouvement
prolétarien international. Nuevo
Curso pose ainsi le problème :
« pourquoi la Seconde Guerre
impérialiste mondiale n’a pas été
transformée, comme la Première, en une
vague révolutionnaire mondiale malgré
les soulèvements en Grèce et en Italie
et la résistance des travailleurs en
Grande-Bretagne et en France ? » (1)
http://www.les7duquebec.com/7-de-garde-2/pourquoi-la-seconde-guerre-mondiale-na-pas-entraine-la-revolution-mondiale/
Répétant l’erreur
de toutes les gauches depuis un siècle
Nuevo Curso commence par
rejeter le matérialisme dialectique et
l’analyse objective de la situation
concrète et répond à cette question
pratique par une envolée lyrique plaçant
l’instance idéologique – la pensée – la
conscience – au poste de commande de
l’évolution économique, sociale,
politique, diplomatique et militaire
mondiale. Nuevo Curso répond à la
question de cette façon : «Les
causes idéologiques de la crise du
mouvement ouvrier, et avec
elles les organisations qui en ont été
responsables, auraient dû être
renversées et détruites. Les
organisations qui ont provoqué la crise
ont accru leur pouvoir organique sur
la classe ouvrière, la liant plus
fortement qu’auparavant au système
général de la contrerévolution mondiale. »
(2) Enfermer dans ce sophisme idéaliste
et s’enfonçant encore davantage dans la
métaphysique intellectualiste Nuevo
Curso ajoute : « Ce résultat
ne peut en aucun cas être accidentel et
encore moins le produit de circonstances
objectives. (…) Le Thermidor
stalinien arriva pour ajouter ses
propres facteurs de crise idéologique
à l’ancien facteur réformiste
(social-démocrate). Depuis lors, le
stalinisme a approfondi sa
dégénérescence, s’accaparant du prestige
du pays de la révolution et des intérêts
de la caste qui a détruit cette
révolution.» (3)
En
d’autres termes, Nuevo Curso
constate que l’histoire ne se répète
pas, et que les conditions particulières
de la Première Grande Guerre qui
avaient permis la Révolution russe de
1917 et une flambée de révolte dans
quelques pays d’Europe, ne se sont pas
reproduites en 1943 – 1945 même s’il y
eut un soulèvement populaire en Espagne
avant la guerre, puis en Italie et en
Grèce pendant et après la guerre, mais
sans provoqué de révolution
prolétarienne internationale.
Le mouvement de
« libération nationale » dans les pays
du tiers-monde
Cependant, les
camarades de Nuevo Curso auraient
pu observer que la Seconde Guerre
a marqué le déclenchement de nombreuses
révolutions bourgeoises anticoloniales
visant à transférer le pouvoir politique
formel aux bourgeoisies nationalistes
tiers-mondistes, condition fondamentale
pour l’expansion mondiale du mode de
production capitaliste comme Nuevo
Curso le remarque à propos de
l’alliance entre le Kuomintang
et le Parti communiste chinois
dans la révolution paysanne antiféodale
en Chine.
« De
la Révolution espagnole à la
Révolution chinoise, la politique
étrangère stalinienne a développé son
cycle dégénératif, qui commence par une
complicité (opportunisme idéologique)
avec la petite bourgeoisie et la
bourgeoisie du Kuomintang et
aboutit à la destruction par sa propre
main de la Révolution chinoise. »
(4)
Au final, la
Seconde Guerre mondiale visait à
étendre et raffermir le mode de
production capitaliste sur le monde et
c’est ce qu’elle a accompli. Après cette
guerre des plus meurtrières, le capital
international étendit son hégémonie sur
le monde entier, y compris sur les pays
ex-colonisés devenus néocolonisés avec
le soutien des empires américain et
soviétique. Les guerres de soi-disant
« indépendance nationale » dans les pays
du tiers-monde ont été le prolongement
de la Seconde Guerre mondiale et ont
permis au grand capital américain
hégémonique d’étendre son pouvoir sur le
monde entier, y compris, après « la
guerre froide » sur les États-nations du
bloc soviétique pseudo communiste.
Nous avons largement débattu de la vraie
nature du mouvement de libération
nationale anticoloniale dans les pays du
tiers-monde dans notre ouvrage
« La question nationale et la
révolution prolétarienne sous
l’impérialisme moderne » (5).
La question de
la révolution sociale
Pour répondre à
cette question historique fondamentale :
« Pourquoi la seconde boucherie
mondiale – ayant fait plus de 50
millions de morts – n’a pas provoqué
l’insurrection populaire puis la
révolution prolétarienne alors que les
forces ouvrières s’étaient largement
accrue et renforcées depuis 1917? »,
il faut au préalable s’entendre sur le
sens à donner aux termes « Révolution sociale »
Une Révolution
sociale consiste à renverser l’ordre
établi sous ses multiples aspects,
c’est-à-dire à renverser l’ensemble des
rapports sociaux de production qui
régissent une société – à renverser le
pouvoir économique – politique –
juridique – carcéral – diplomatique –
militaire – idéologique – médiatique qui
ordonne cette société. Cette éradication
– destruction n’est pas achevée tant
qu’un nouveau mode de production et de
nouveaux rapports sociaux de production
n’ont pas été érigés pour ordonner la
nouvelle société assurant sa
reproduction et son
expansion…c’est-à-dire la reproduction
de l’espèce humaine.
La seconde question
fondamentale consiste à déterminer la
nature d’une révolution. Ainsi,
quelle était la nature de la
Révolution russe et bolchévique?
Toute la gauche historique vous répondra
que ce fut une révolution socialiste
prolétarienne puisqu’elle était
dirigée par le grand Parti communiste
bolchévique de Russie commandé par
le grand Lénine et par
Staline le petit père des
peuples pour les uns, et par
Trotski pour les autres. Passons
sur le peu de cas que ces communistes
font des «masses populaires et des
classes sociales» qui, disait Marx,
forgent l’histoire. Chez ces communistes
ce sont les chefs adulés qui font
l’histoire, et on quitte ainsi le
terrain de la révolution pour celui de
la religion sectaire et dogmatique.
La nature d’une
révolution sociale
La nature d’un mets
ne dépend pas du cuistot, mais des
ingrédients qui le composent. Ce ne sont
pas les leadeurs charismatiques qui se
choisissent une classe révolutionnaire à
leur gout et à leur service, mais c’est
la classe révolutionnaire qui choisit
les chefs qu’elle juge apte à répondre à
ses aspirations. Cette sélection
naturelle ne se fait pas par élection
« démocratique » bourgeoise. Nous
verrons plus loin comment Lénine
s’y est pris pour arracher l’adhésion de
la paysannerie russe. Dans le débat sur
la nature d’une révolution sociale les
ingrédients ce sont les classes sociales
qui s’affrontent. Ce qui nous fait dire
que la Révolution russe confrontant les
restes de l’aristocratie féodale
tsariste solidement au pouvoir
politique, une bourgeoisie montante,
mais encore peu puissante politiquement,
soutenue par une petite-bourgeoisie
bureaucratique, une immense paysannerie
comptant dit-on 135 millions d’individus
analphabètes, et un petit prolétariat (3
à 5 millions d’esclaves salariés) encore
bien incapable d’imaginer et de créer le
mode de production communiste
prolétarien du XXIe siècle.
Lénine avait
compris la nature de la Révolution
bourgeoise russe qui s’appuyait sur
l’immense paysannerie pour renverser
l’aristocratie tsariste, paysannerie
chair à canon appâtée par la promesse de
terres à se partager… qui furent bien
peu utile dans les usines d’armements
soviétiques. Lénine un
petit-bourgeois pragmatique lança des
mots d’ordre adaptés à la classe
paysanne révolutionnaire. Ainsi, il
n’insista pas sur la réquisition des
terres, mais il promut le slogan
réformiste « Pain, Paix, Terre »
correspondant parfaitement aux exigences
de l’immense paysannerie prête à
sacrifier sa vie pour ces
revendications, mais certainement pas
pour accréditer : « Tous le
pouvoir aux soviets » que
Lénine, pragmatique, abandonna
rapidement quand le parti bolchevique
perdit la majorité dans les principaux
soviets urbains. Pour ce qui était des
prolétaires, le pain ils avaient et la
terre ils ne savaient qu’en faire, et la
paix, personne dans toutes les Russies
ne la connaitra avant sept ans.
Les insurrections
populaires de 1917-1918-1919 en Europe
ne furent pas des soulèvements
prolétariens, mais des soulèvements de
paysans, d’artisans et de petits
bourgeois auxquels le prolétariat
apporta son soutien. De ces luttes
sociales, de ces escarmouches de classe
parfaitement justifiée le prolétariat a
obtenu quelques concessions, ce que la
gauche aime appeler des «acquis sociaux»
tous en train de disparaitre sous les
coups de la crise systémique.
Il n’y a pas eu
de Thermidor stalinien ni de Vendémiaire
léniniste
Bref,
Octobre 1917 ne fut jamais une
Révolution prolétarienne et pas plus
qu’il n’y eut de Vendémiaire
léniniste il n’y eut de
Thermidor stalinien. La
nomination de Staline au poste
suprême ne fut qu’une « révolution » de
palais dans les rangs de la nouvelle
classe dirigeante bolchevique regroupée
au sein du Parti communiste d’Union
soviétique dont l’empire
étatique-socialo-capitaliste avait
commencé à s’étendre. Attention de ne
pas confondre les termes « empire » et
« impérialisme » qui sont très
différents. Nous y reviendrons
ultérieurement. En 1923, la nouvelle
puissance industrielle soviétique était
à un carrefour; soit s’épuiser dans une
suite de guerres civiles interminables
pour aboutir exsangue à l’effondrement;
soit régler la succession dans la
continuité de la NEP et construire le
mode et les rapports de production
capitalistes sur les cendres de l’empire
féodal tsariste déchu. Staline
fut le choix des nouveaux
apparatchiks à cause de son pragmatisme,
car il opta pour la deuxième voie plutôt
que de deviser à propos d’une fumeuse « Révolution
permanente ». Tout autre choix
aurait entrainé des années d’illusions,
du verbiage romanesque et des guerres
sans fin à propos d’un prétendu premier
État communiste prolétarien sans
prolétaires. En lieu et place, les
masses paysannes russes et les
bolchéviques optèrent pour construire le
capitalisme dirigiste d’État qu’ils
appelèrent « socialisme » de
transition entre le féodalisme et le
communisme et que nous appelons
capitalisme étatique.
Le reste n’est que
la petite histoire que connaissent les
coups d’État avec les cliques qui se
composent et se décomposent, les
collaborateurs d’hier qui passent au
peloton d’exécution, la propagande
dogmatique et sectaire qui tient lieu
d’analyse matérialiste dialectique et ne
mérite pas que nous nous y attardions.
Les soviétologues en ont fait une
profession, très peu pour nous. Oui, en
effet, les tenants de la « Révolution
permanente » furent écartés, mais ne
furent pas évitées les guerres
d’intervention étrangères que l’immense
paysannerie et le chétif prolétariat de
toutes les Russies allaient devoir
affronter pour sauver leur
« patrie prolétarienne » en danger
(sic). Nous avons bien écrit la
«patrie prolétarienne» en danger et non
le mode de production communiste
prolétarien en danger.
La Seconde
Guerre mondiale
Passons maintenant
à la Seconde Grande Guerre mondiale
et à l’Italie de 1943. Comme pour la
guerre précédente, l’idéologie – la
conscience de classe – et le
positionnement conséquent des partis
politiques n’expliquent pas l’histoire
de cette guerre dont les conditions se
sont forgées au cœur même du mode de
production capitaliste en phase
impérialiste ascendante. En effet, après
les troubles de 1914-1919 (y incluant
l’insurrection allemande) le mode de
production capitaliste s’était raffermi
autour du pôle de Wall Street
et au détriment de la City
britannique, mais la partie n’était pas
complètement jouée. Sur le continent
européen, le prolétariat grandissait à
vue d’œil de l’apport de millions de
paysans chassés de leurs terres par
l’État (Union soviétique) ou par les
industriels, avec la complicité des
anciens aristocrates propriétaires
fonciers et des banquiers usuriers.
Qui dit prolétariat
en expansion dit aussi mode de
production industriel capitaliste en
expansion malgré la Grande crise – ou à
travers la Grande Dépression.
Le monde impérialiste ne pouvait se
déployer ainsi dans la totale anarchie
et les guerres fratricides pour se
disputer les marchés. D’autant que la
nouvelle puissance soviétique, comptant
déjà un sixième des terres émergées,
lorgnait les Balkans, la Pologne et la
Tchécoslovaquie.
À partir du moment
où les partis communistes, regroupés
dans la Troisième Internationale
sous la houlette de Dimitrov,
l’homme des Soviétiques, prêtèrent
allégeance à la nouvelle puissance,
« patrie » des ouvriers du monde entier,
ils cessèrent d’être une variable
importante dans l’équation
révolutionnaire. La montée en puissance
du Parti national-socialiste
germanique (aux ordres du grand
capital allemand), marquée de jeux
électoralistes et parlementaires dignes
des sociaux-démocrates d’avant-guerre,
suffit à comprendre que la révolution
prolétarienne n’était pas à l’ordre du
jour. Trop de conditions
révolutionnaires objectives et
subjectives faisaient défaut. En effet,
ce ne sont pas les partis de la
soi-disant avant-garde qui forgent la
conscience (conditions subjectives) des
masses prolétariennes, mais l’inverse.
Les conditions objectives de la
révolution prolétarienne n’étant pas
mures, les conditions subjectives ne
pouvaient l’être et le risque était
grand de se retrouver avec une
«avant-garde» donnant l’ordre de
l’insurrection à une armée d’ouvriers
démobilisés.
La nature
profonde de la Seconde Guerre mondiale
La
guerre de 39-45 fut le prolongement – la
deuxième manche – de la Première
Grande Guerre, mais dans des
conditions très différentes pour le
grand capital international qui la
fomenta. Il est antimatérialiste
historique de prétendre que : «À lui
seul, le gouvernement russe stalinien a
beaucoup plus contribué à la défaite de
la révolution mondiale et à l’état de
prostration des masses que tous les
anciens gouvernements capitalistes
réunis.» (6) Toutes les factions
bourgeoises à l’Est comme à l’Ouest
partagent équitablement leur part de
responsabilité dans ce conflit
inévitable puisque le mode de production
capitaliste c’est la guerre. Et la
guerre est justement la force qui peut
pousser le prolétariat vers la
révolution sociale. Lénine avait tort de
prétendre que : «La guerre
entraine la révolution ou la révolution
conjure la guerre». La
révolution sociale n’a jamais conjuré la
guerre sinon une classe sociale qui
serait capable d’une telle lucidité ne
serait pas aliénée. Ainsi, ce n’est pas
non plus « l’existence d’un parti
révolutionnaire muni d’une théorie
révolutionnaire » qui assure
l’éclatement de la révolution
prolétarienne, mais l’inverse. La
conscience ne précède pas le mouvement,
la conscience est l’enfant du mouvement.
De l’insurrection populaire
internationale, émergeant de
l’effroyable guerre nucléaire
réactionnaire, surgira de la classe
révolutionnaire en mouvement le parti de
la révolution, qui forgera sa théorie
révolutionnaire en contribuant à la
révolution prolétarienne.
L’insurrection populaire spontanée et
anarchique est un moment préalable et
nécessaire à la révolution prolétarienne.
Revenons au grand
capital international qui après 14-18
avait poursuivi son ascension et son
expansion impérialiste dans une partie
de l’Asie, en Amérique latine, dans une
portion de l’Afrique. Le grand capital
avait étendu ses tentacules et avait
augmenté la productivité du travail
salarié, donc les taux moyens de profit
de manière différenciée suivant les pays
et les continents. Le grand capital
international pouvait enfin ambitionner
exploiter la totalité de l’humanité, et
contrôler tous les marchés, ce qui
n’était absolument pas le cas en 14-18.
Ainsi, la Seconde Guerre fut
l’occasion de multiples inventions et
innovations, ce fut une guerre mécanique
et technique au diapason de l’avancée
des moyens de production et de
marchandisation et elle entraina une
poussée des indices de productivité. Les
partis de gauche, discrédités à cause de
leur collaboration réformiste que les
circonstances du moment exigeaient,
furent délaissés par les ouvriers sans
discontinuer jusqu’à aujourd’hui, un
vacuum que la « nouvelle gauche
revendicatrice »
petite-bourgeoise tente présentement de
combler.
Si la gauche a pu
contribuer à liquider l’insurrection
populaire, et la révolution prolétaire,
avant et après 39-45, ce n’était pas
pour malfaire ou par trahison de ses
pairs, mais parce qu’elle a poursuivi la
politique de coexistence réformiste que
lui imposait la bourgeoisie et dont
s’accommodait le prolétariat. L’histoire
est ingrate, elle a congédié l’acteur
gauchiste qui a pourtant joué son rôle
pour la raison que les conditions
objectives et subjectives de la
révolution n’étaient pas mures. Cette
immaturité objective se reflétait dans
le niveau de conscience subjective de la
classe révolutionnaire. Nous le
répétons, le mouvement crée la
conscience et non l’inverse. Les
conditions objectives précèdent les
conditions subjectives qu’elles font
avancer.
Depuis que
l’économie capitaliste est sortie de la
Grande Dépression, les forces
productives sociales sont en progression
et la valorisation du capital est en
ascension. Une révolution sociale ne
survient jamais dans une période
d’expansion d’un mode de production. Une
révolution sociale ne survient que dans
les périodes de régression économique,
et par conséquent politique et
idéologique, dans les périodes de
décadence morale et de grande misère
sociale. Une révolution sociale obéit à
d’autres lois impératives inscrites dans
le génome de l’évolution des modes de
production. Ainsi, une société ne peut
sauter, contourner ou éviter une étape
(un mode de production) dans son
évolution. Même Marx, le grand
Lénine, Staline, Trotski, Mao, Hodja ou
Castro ne peuvent échapper à
cette loi formulée par Marx. Une
autre loi formulée par Marx dit qu’un
mode de production ne disparait jamais
avant de contenir et/ou de faire
fructifier toutes les forces productives
que ses rapports sociaux de production
peuvent lui permettre d’exploiter.
Ni en 1917, ni en 1943, ni en 1949, ni en 1968, ces
conditions objectives impératives
n’étaient réunies. Présentement,
l’expansion planétaire jusqu’aux confins
de la Chine, de l’Inde et de l’Afrique,
et l’hyperconcentration du capital se
complètent à grands pas ce qui nous
porte à croire que le mode de production
capitaliste remplira bientôt toutes les
conditions objectives de son
renversement. Le temps de la régression
économique déjà amorcée sera bientôt
dominant et permanent et le vent du
changement social révolutionnaire sera
dans l’air du temps, ce qui entrainera
le murissement de la conscience sociale
collective chez la classe prolétaire
révolutionnaire. Le mouvement des « carrés
rouges » au Québec en 2012 et le
mouvement des « gilets jaunes »
en France en 2018 en sont des signes
avant-coureurs. (7)

NOTES
Reçu de Robert Bibeau pour
publication
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Le
dossier Monde
Le
dossier Monde
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

