Les 7 du Québec
L'histoire génocidaire des États-Unis
d'Amérique
Robert Bibeau
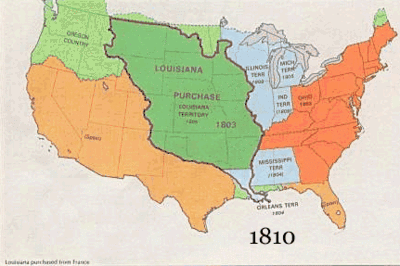
Mercredi 11 janvier 2017
http://www.les7duquebec.com/...
Les États-Unis d’Amérique ont été créés
au XVIIIe siècle suite
à l’expansion de l’Empire britannique
première puissance mondiale de l’époque,
sur lequel le soleil ne se couchait
jamais. En tant qu’extension du sanglant
impérialisme britannique, la destinée de
ce pays ne pouvait dévier d’une
agressive expansion multinationale comme
je le soulignais dans un texte
récent : « Depuis sa création, en
1776, la République des États-Unis
d’Amérique a été en guerre 220 de ses
240 années d’existence. Chaque Président
yankee a promis la paix et a semé la
guerre. Donald Trump promet la paix et
la prospérité, il fera la guerre et il
sèmera la pauvreté, ni plus ni moins que
la prétendante Clinton ne l’aurait fait
si elle avait été élue » sans
compter que depuis 1945 le pays a
provoqué environ 200 conflits régionaux
(1).
Les États-Unis sont
nés dans et par la guerre ; d’abord
contre l’empire français et sa
Nouvelle-France qui deviendra le Canada
au nord (vallée du St-Laurent) et à
l’ouest (vallée du Mississippi), contre
l’Espagne au sud et contre la
Hollande au centre. New Amsterdam sera
renommé New York après cette première
conquête (1664), puis ce furent les
« natives », les Amérindiens, qui furent
confrontés à l’expansion de cette nation
née dans l’adversité.
Dans leur guerre
contre les Amérindiens, ce ne fut pas un
désir morbide de massacre génocidaire
qui poussa le gouvernement, la
bourgeoisie américaine et la cavalerie
de Custer vers les plaines de l’ouest,
ce fut simplement deux modes de
production incompatibles qui se
confrontèrent, le mode de production
communiste primitif, fondé sur la chasse
et la cueillette, opposé au capitalisme
commercial, puis industriel et enfin
financier, le plus expansionniste du
monde moderne, avec Wall Street
comme centre névralgique mondiale (2).
N’en déplaise aux écologistes il était
facile de savoir quel mode de production
allait survivre en éliminant son
concurrent.
Les États-Unis
furent poussés inexorablement contre la
France (dont ils acquirent la Louisiane
en 1803), contre le Canada (guerre de
1812), contre les restes de l’Empire
espagnole (1819), contre le Mexique
(1845-1853), puis deux factions du
capital se tournèrent l’une contre
l’autre, la Confédération esclavagiste
du Sud, contre l’Union capitaliste du
Nord (1861-1865). Plus de 620 000
travailleurs-soldats y laissèrent la
vie, puis la marche sanguinaire vers
l’Ouest repris. Plus tard, ils
s’attaquèrent à l’Empire britannique et
au Second Empire français qu’ils
désintégrèrent afin d’imposer
l’impérialisme moderne – financier – en
lieu et place de l’impérialisme
colonial-commercial, ancien, qui ne
pouvait survivre puisqu’il provoquait
l’ire et les soulèvements constants des
bourgeoisies nationales coloniales
souhaitant s’affranchir des métropoles
oppressives, pour se poser en
intermédiaires nationaux de
l’exploitation de la force de travail
locale, livrant eux-mêmes la plus-value
à l’impérialisme mondialisé – globalisé.
Toutes les guerres de soi-disant « libération
nationale » portèrent exclusivement
sur ce point crucial, quelle part de
l’exploitation du travail salarié locale
sera accaparée par la bourgeoisie
nationaliste et quelle part sera
abandonnée aux capitalistes étrangers ?
C’est ce que Théodore Roosevelt compris
avant Lénine et les bolchéviques,
sentiment nationaliste chauvin que les
É.-U. exploitèrent pour déloger les
ex-puissances coloniales commerciales
concurrentes et y substituer
l’impérialisme financier sur lequel
Lénine a écrit brillamment en spécifiant
que même opposé au capitalisme
colonial-commercial, l’impérialisme
financier n’en exploite pas moins la
classe prolétarienne, unique productrice
de plus-value, et qui demeure l’ennemi
juré de la classe capitaliste
mondialisée (3).
Le conflit
irréconciliable dégénéra en guerre
totale entre l’empire des soviets et
l’empire occidental, européen d’abord,
américain ensuite, quand il apparut
évident que les bolchéviques
n’entendaient pas partager les fruits de
l’exploitation du prolétariat soviétique
avec l’impérialisme occidental. La
guerre à finir entra alors dans une
phase qui, après moult tribulations,
allait se conclure en 1991 avec le
triste sire Boris Eltsine, indigne
thuriféraire mortuaire de l’Union des
Républiques Soviétiques.
Pendant un siècle
les États-Unis se firent les alliées de
ces bourgeoisies nationalistes
tiers-mondistes (pseudo non alignées)
désirant partager avec les marchands de
guerres occidentaux une partie de la
plus-value produite localement. Et vous
avez vu Mandela se pavaner sur les
estrades de l’anti-apartheid onusien
(que les Sud-Africains subissent
toujours), Ho chi Minh, Pol Pot,
Ceausescu, Tito, Nasser, Gandhi, et les
autres, tous heureux de collaborer avec
les génocidaires É.-U., pour obtenir
leur pitance nationale, plus abondante
que ce que leur proposait Staline,
Khrouchtchev et Brejnev, dirigeant d’un
empire industriel désuet, pré-financier.
Aujourd’hui, nous voyons Castro – le
frère de l’autre – qui parcourt son
chemin de Canossa afin d’obtenir un
saufconduit des États-Unis pour son
intégration au mode de production
capitaliste.
Il faut en
convenir, l’éviction de l’impérialisme
yankee et mondial sera la tâche du
prolétariat international. C’est à
dessein que nous n’avons pas mentionné
les « peuples », les bourgeoisies
chauvines, ni les « nations »,
soi-disant opprimées, chères aux
gauchistes déjantés. La question posée
et à résoudre est de savoir si cette
éradication surviendra avant ou après la
guerre mondiale génocidaire
que l’impérialisme prépare, et surtout
si cette éviction ne sera qu’un
changement de maitre impérialiste ou
l’avènement d’un nouveau mode de
production communiste ?
NOTES
(1)
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/trump-un-president-comme-les-autres-donald-sen-va-ten-guerre/
(2) Il
y a plus de trois-cent-cinquante ans,
Wall Street n’était qu’une route en
terre, le long de laquelle les colons
hollandais construisirent un mur
fortifié, en 1653, dans le but
d’empêcher les colons britanniques de
passer. Bien qu’aucune bataille ne
marqua l’histoire du mur mesurant plus
de 3,5 mètres de hauteur et qu’il fut
finalement démoli en 1699, son nom est
resté («Wall» signifie «mur», en
anglais). Au cours du XVIIIe siècle,
Wall Street hébergea des commerçants qui
se rencontraient pour faire des échanges
de produits et services, mais ce n’est
pas avant 1790 que furent émis les
premiers placements faisant l’objet
d’une négociation publique. C’est à
cette période que la Bourse de New York
vit le jour. Il s’en suivit un siècle de
croissance rapide pour Wall Street et
pour le marché boursier.
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,3491,00.html
(3) Lénine (1916)
L’impérialisme stade suprême du
capitalisme. Édition de Pékin
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

