Les 7 du Québec
L'état au service de la classe
dominante
Robert Bibeau
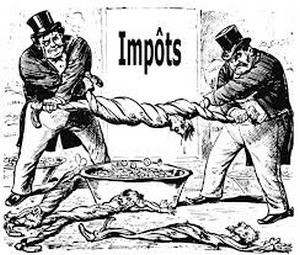
Mercredi 3 août 2016
http://www.les7duquebec.com/...
L’objectif de Tom Thomas dans ce volume
« Étatisme contre libéralisme ? »
(1) est de combattre l’utopie étatique.
Une utopie largement sacralisée par la
droite et par la gauche bourgeoise à
travers les luttes électorales
auxquelles elles convient les militants
et les prolétaires dans le triste espoir
d’accéder à la direction de l’État-major
de la bourgeoisie et de devenir des
affidés des oligarques financiers.
Tom
Thomas y démontre que l’État ne peut
être le moyen d’une solution à la crise
économique systémique du capitalisme et
à ses effets catastrophiques, « pour
la raison qu’il ne peut pas être autre
chose que l’organisateur essentiel de la
reproduction du capitalisme (c.-à-d. des
rapports sociaux capitalistes) et de
plus en plus essentiel au fur et à
mesure de son développement
historique ». Le livre démontre que,
pire encore, « tout renforcement du
rôle de l’État bourgeois ne peut être
qu’un renforcement de la dépossession
des travailleurs des moyens de leur vie,
un renforcement de la domination sur eux
du capital (éventuellement étatisé) et
de ses représentants, les bourgeois
(appelée par Marx « les fonctionnaires
du capital » parce qu’ils ne font qu’en
exécuter les lois). Cela quelles que
soient les promesses de démocratie
« participative », « citoyenne »,
« républicaine », ou autres
qualificatifs qu’on y adjoint comme pour
admettre qu’elle n’est rien ! » (2)
Le
volume démontre que cet étatisme
capitaliste contemporain « n’est pas
un fait du hasard, un choix parmi
d’autres, mais qu’il manifeste une
tendance au totalitarisme inhérente à
l’essence même de l’État et dont le
plein développement accompagne
nécessairement celui du capital arrivant
à son âge sénile », arrivant
dirons-nous à son stade ultime –
impérialiste – qui exige, comme on l’a
vu à maintes reprises dans l’histoire,
un appareil de gouvernance totalitaire
pour ne pas se défaire et s’écrouler.
L’État n’a pas été créé spécifiquement
pour favoriser certains individus, pas
même une classe sociale en particulier,
mais parce que nécessaire pour
reproduire une société dans son ensemble
(au nom du soi-disant intérêt général) ;
société dans laquelle une classe est
dominante parce que propriétaire des
moyens de production, d’échanges et de
communication. C’est en s’attachant à
reproduire ce qui fonde cette société
que l’État fait valoir les intérêts de
la propriété privée sur le capital, et
crée les conditions de la destruction de
ce mode de production en le
collectivisant à travers une classe
sociale minoritaire, l’aristocratie
financière capitaliste, de laquelle sont
exclus toutes les autres classes et
fractions de classes y compris la petite
bourgeoisie rejetée et paupérisée, d’où
sa frustration et ses protestations.
C’est
en ce sens que l’État est « la
forme par laquelle les individus d’une
classe dominante font valoir leurs
intérêts communs et dans laquelle se
résume toute la société civile d’une
époque » (3). Mais cette forme
provient elle-même de ce que les
individus bourgeois ne peuvent
administrer et gouverner eux-mêmes,
directement. C’est par et dans l’État
que les individus bourgeois s’organisent
en classe dominante, unifiant leurs
différentes fractions, et garantissent
leurs intérêts essentiels – le capital
et sa reproduction élargie – finalité du
développement de ce mode de
production (4). Ils doivent passer par
cette forme singulière, donner à ces
intérêts particuliers une forme
politique extérieure à eux comme
individu – mais jamais en tant que
classe – (même si, évidemment, ils
l’influencent fortement par toutes les
ressources qu’ils détiennent), devant
apparaitre formellement comme la volonté
sociale générale et, pour cela, se
légitimer aussi auprès des classes
dominées « C’est justement
cette contradiction entre l’intérêt
particulier et l’intérêt général qui
amène l’intérêt collectif à prendre, en
qualité d’État, une forme indépendante,
séparée des intérêts réels de l’individu
et de l’ensemble et à faire en même
temps figure de communauté illusoire…
Précisément parce que les individus ne
cherchent que leur intérêt particulier
qui ne coïncide pas pour eux avec leur
intérêt collectif… cet intérêt est
présenté comme un intérêt qui leur est
étranger, qui est indépendant d’eux… » (5).
Ce qui
frappe le plus dans cette évolution de
l’État vers des formes qui tendent à le
faire apparaitre comme le représentant
des intérêts de toute la société civile
(sic), comme au-dessus des classes, des
fractions de classes, et des intérêts
particuliers, ce sont deux choses :
Premièrement cette évolution fut
inéluctable. L’État bourgeois n’est donc
pas le fruit de circonstances
particulières et momentanées, il est
surtout, bien au-delà du cas concret
particulier du totalitarisme, le fruit
incontournable d’une évolution en
profondeur du mode de production
capitaliste lui-même, ce qui fait que
non seulement cette domination de l’État
sur les individus et sur les intérêts
particuliers n’a cessé de s’affirmer,
mais une évolution similaire s’est
produite ailleurs, avec la même
transformation du mode de production
capitaliste, indépendamment de
circonstances historiques régionales.
Deuxièmement, concernant le procès
de construction de l’État bourgeois de
sa forme démocratique bourgeoise à sa
forme totalitaire bourgeoise, ce n’est
pas le fait qu’un dictateur y exerce un
pouvoir despotique qui est le plus
significatif, mais justement, au
contraire et contrairement à ce que
propagent les médias à la solde, que la
personnalité de ces despotes n’a aucune
importance. Hitler, Staline, Mussolini,
Franco ou Hirohito, l’État joue son rôle
normal dans le développement « normal »
de la société bourgeoise dans un
capitalisme en crise systémique sur
laquelle il n’a aucun pouvoir en
définitive. Comme l’observe
judicieusement Marx, avec ses millions
de fonctionnaires l’État bourgeois forme
« un effroyable corps parasite qui
recouvre comme d’une membrane le corps
de la société française et en bouche
tous les pores » (6). Cet énorme
appareil bureaucratique, si imposant
aujourd’hui – jusqu’à faire penser à un
mystique « État providence »
égérie de la petite bourgeoisie –
fonctionne par lui-même comme une
machine automate, et pourvu qu’on le
nourrisse copieusement d’impôts, avec
ses appareils, son langage, ses règles,
ses automatismes aveugles, et son
monopole de la violence légale. Il
fait ce pour quoi il a été construit :
organiser la reproduction de la société
capitaliste, et particulièrement assurer
la reproduction de la force de travail
source de la plus-value et du capital,
de sorte que n’importe quel gouvernement
– président – Premier ministre – peut
se trouver à sa tête, la machine
marchera plus ou moins bien, mais
produira à peu près toujours les mêmes
résultats. N’importe quel
polichinelle peut faire l’affaire !
Georges Bush, Barack Obama, Hilary
Clinton ou Donald Trump, peu importe
puisque maintenant l’État est un
appareil indépendant des individus et
des factions qu’il gouverne, et même
aussi de ceux, les élus, qui le
gouvernent. « Semble, car
répétons-le, indépendant des individus
ne veut pas dire indépendant de la
société capitaliste, donc des intérêts
de la classe qui en est la bénéficiaire
et y domine en réalité. L’État est bien
responsable de la reproduction du
capitalisme, c’est même sa seule
fonction (et c’est bien pourquoi ce
sont les exigences générales du capital
qui gouvernent les gouvernants, du
moins dans la mesure de ce qu’ils en
comprennent, de l’influence plus
particulière de tel ou tel secteur
capitaliste à tel ou tel moment, etc.)
Indépendant, cela veut dire aussi que ce
ne sont pas nécessairement les
capitalistes eux-mêmes qui « règnent »
au sommet de l’État, qui joue son rôle
par lui-même, indépendamment des hommes
qui se succèdent à sa tête et des formes
plus ou moins démocratiques ou
despotiques qu’il revêt » (7).
« En
Allemagne, la construction de
l’État-nation intervint plus tard avec
Bismarck (qui avait pris des leçons de
Napoléon III, qu’il admirait, comme
ambassadeur à Paris). Compte tenu du
retard du capitalisme allemand, donc de
la faiblesse de sa bourgeoisie
relativement à la survivance de forces
aristocratiques (propriété foncière), et
de divisions territoriales relativement
forte, il dut l’effectuer « par le haut
», le pouvoir monarchique organisant
lui-même l’accouchement d’une société
capitaliste et de l’État correspondant,
sur le gouvernement duquel l’empereur
gardait de ce fait une forte emprise.
L’alliance avec la classe ouvrière fut
là aussi nécessaire pour briser les
résistances des aristocrates et des
forces conservatrices, mais elle ne
surgit pas du « bas », dans
l’insurrection. C’est l’État qui
l’organisa à sa façon (cf. par exemple
le Kulturkampf 1873-1879). C’est
l’aristocrate et autocrate Bismarck qui
fit voter les premières lois sociales en
faveur des ouvriers d’industrie :
assurance maladie (1878), assurance
contre les pertes d’emploi dues aux
accidents du travail (1884), assurance
vieillesse invalidité (1889). Par ces
lois sociales, il voulait organiser
l’intégration pacifique, mais aussi
entièrement disciplinée et soumise, du
prolétariat (…) En Angleterre, la
bourgeoisie, déjà ancienne et puissante,
crée d’abord par elle-même des sociétés
de secours mutuel pour ses ouvriers
(plus de 4 millions de membres vers
1870), et des sociétés philanthropiques
pour les pauvres. Mais la charité
bourgeoise étant tout à fait
insuffisante à entretenir une force de
travail nombreuse et surexploitée, c’est
l’État qui là aussi devra prendre
progressivement en charge cette fonction
(comme il avait d’ailleurs commencé à le
faire par les Poor Laws de 1642 et
1834). Finalement, dans tous les pays
capitalistes à partir de la fin du 19e
siècle, « l’Etat va peu à peu supplanter
les groupements privés dans la sphère de
la reproduction sociale… », avec toutes
sortes de nuances «… mais le plus
souvent sur le modèle des assurances
sociales « inventées » par l’Allemagne
de Bismarck » (8).
C’est
l’État, plus que le mouvement ouvrier,
qui avait l’initiative. « Dans
quasiment aucun pays, durant cette
période, le mouvement ouvrier n’a joué
un rôle en tant qu’initiateur et
supporteur actif et enthousiaste des
assurances sociales » (9). C’est que
nombre d’ouvriers voient encore l’État
comme purement répressif, exclusivement
au service des bourgeois, un ennemi dont
il ne peut ni ne doit rien attendre
(sinon le pire comme l’avait démontré
l’écrasement de la Commune de
Paris). L’autre motif pour
expliquer la suspicion ouvrière
vis-à-vis ces plans d’assurances et
d’assistance sociales c’est que les
travailleurs actifs (en emplois) savent
pertinemment que ce sont eux qui
défraieront ces programmes par leurs
cotisations. Récemment, aux États-Unis,
un programme d’assurance maladie a été
boudé par les ouvriers – surtout ceux
que l’on appelle les « poors workers » –
qui peinent à survivre avec leurs
salaires de misère, ce que la gauche
bourgeoise a dénoncé, se portant ainsi
au secours du Président américain
« charitable ». Pendant ce temps, l’État
bourgeois est tenu d’assurer les
conditions de reproduction élargie du
capital. La première de ces conditions,
en phase montante du développement
capitaliste – à son stade ultime
impérialiste – juste avant le grand
basculement – c’est de reproduire le
capital variable – vivant – prolétarien,
sinon aucune plus-value ne sera produite
et aucun capital ne sera valoriser, ni
ne pourra être distribué et réinvesti.
L’État providence n’est
que la réponse particulière que les
rapports de production capitalistes ont
engendrée pour assurer la reproduction
élargie du capital. L’État
providence, éphémère, n’est pas
une conquête de la classe ouvrière comme
le laisse entendre la gauche bourgeoise
qui aujourd’hui tente de mobiliser les
prolétaires pour qu’ils se battent pour
maintenir ces « privilèges »
temporairement accordés, les emplois
syndicaux, les emplois en ONG
subventionnés et les jobs des clercs
gestionnaires de ces programmes
d’assurance et d’assistance publics.
À
partir du moment où le capital variable
– vivant – ouvrier – est devenu trop
abondant par rapport aux besoins du
capital constant à valoriser, dans le
monde entier l’État bourgeois a changé
de politique pour s’orienter vers le
« néolibéralisme » comme l’appel la
gauche déjantée, il est devenu l’État du
rationnement et de l’austérité. En
effet, pourquoi assurer la reproduction
élargie d’un capital vivant
surabondant ? On perçoit ici toute la
fumisterie des protestations gauchistes
visant à conquérir de nouveaux « droits
sociaux », à maintenir les « droits
acquis » et à conserver les « conquêtes
ouvrières » des périodes de prospérité.
Sous la crise économique systémique du
capitalisme il n’y a plus de pseudo
« droits acquis » qui tiennent, sauf le
droit acquis du capital d’assurer ses
profits à tout prix.
Préoccupé par nature de son seul profit
immédiat, et d’ailleurs obligé de le
faire par la concurrence immanente, le
capitaliste individuel ne s’occupe que
de consommer le plus de travail salarié
au moindre cout, et il ne s’inquiète pas
de sa reproduction, persuadé qu’il
trouvera toujours les bras dont il a
besoin pour « profiter ». Il a fallu
longtemps aux plus lucides d’entre eux
pour comprendre que les conditions de
misère et d’avilissement épouvantables
des ouvriers des débuts du capitalisme
étaient un frein, un danger mortel, pour
le système capitaliste lui-même, et que
le capital avait besoin d’une force de
travail apte, en bonne santé, éduqué et
former pour performer avec forte
productivité. Chaque capitaliste ne
pouvant affronter seul l’organisation
militante du prolétariat ce qui oblige à
des réponses au niveau de l’État comme
l’ont prouvée les montés de fièvre
ouvrière insurrectionnelle. Bref, l’État
doit intervenir de plus en plus pour
réunir les conditions de valorisation du
capital, aussi bien en prenant en charge
divers investissements lourds (chemins
de fer, ports, oléoducs, aéroports,
réseau électrique) que la reproduction
de la force de travail (éducation,
santé, sport, loisirs) et la gestion de
la lutte des classes (formule rand,
comités paritaires et subventions aux
organisations syndicales et
associatives).
Tom
Thomas signale qu’« avec les lois
sociales, l’État devient petit à petit
un gestionnaire du rapport salarial qui
s’impose comme le rapport social
dominant. Ce qui était naguère
soi-disant des contrats purement privés
entre individus réputés « égaux »
devient ainsi contrat social étatisé.
L’État produit et impose par la loi le
contrat social et salarial, de sorte
qu’il semble que l’État joue le rôle
d’une puissance arbitrale, qui pourrait
décider de favoriser les salariés pour
peu que les résultats électoraux portent
leurs représentants au pouvoir. En
réalité, il ne fait, par ces lois, que
leur redistribuer une petite partie des
richesses qu’ils ont produites et qu’il
a confisquées (…), mais après s’être
lui-même copieusement servi au passage.
Il ne fait qu’organiser une
mutualisation des risques entre les
travailleurs, mais sans eux. L’ouvrier
accidenté, malade ou chômeur ne
demandera plus justice… en descendant
dans la rue. Il fera valoir ses droits
auprès d’instances administratives… Mais
cela (ces droits) ne lui
donne aucun pouvoir sur la direction de
l’entreprise ou sur l’État » (10). Pire,
dirons-nous, même si, à la faveur d’une
élection, un parti soi-disant ouvrier
décroche le pouvoir d’État bourgeois, il
ne pourra qu’appliquer la politique
capitaliste qui s’impose compte tenu de
la conjoncture économique de crise. S’il
ne le fait pas, ce parti sera battu aux
élections suivantes dans un État en
faillite et au milieu d’un « backlash »
politique catastrophique. Le mode de
production capitaliste a ses lois qui ne
souffrent aucun passe-droit.
Certes, le capitaliste peut geindre que
ces prélèvements de cotisations sociales
par « l’État providence »
(sic) est un cout salarial qui vient
réduire la part de surtravail qu’il
pourrait convertir en profit pour lui.
« Il peut protester que l’État se
fait payer fort cher pour assurer ce
service, que la productivité de sa
bureaucratie est très faible. Mais c’est
une part qu’il doit accepter de lui
laisser, malgré qu’il la convoite, pour
prix de son incapacité à organiser par
lui-même la reproduction de la force de
travail et du rapport salarial. Il peut
pester contre l’État, vociférer comme
Harpagon après sa cassette et crier
comme lui qu’on l’assassine, la
socialisation étatisée des risques
(accidents du travail, maladie, santé,
etc.) lui permet de pouvoir puiser, dans
le vivier de force de travail ainsi
entretenue, celle dont il aura besoin à
tel ou tel moment, qu’il trouvera ainsi,
grâce à l’État qu’il maudit, disponible,
apte, en état. Cette étatisation de la
reproduction de la force de travail est
une utilité pour le capital, quoi qu’en
dise le capitaliste particulier qui en
discute âprement le prix. Elle lui
assure non seulement ce vivier sans
lequel il ne pourrait pas produire de
plus-value, et dans des conditions
égalisées de concurrence, mais aussi
l’entretien par les ouvriers eux-mêmes
de « l’armée de réserve » des chômeurs
si essentielle pour maintenir les
salaires le plus bas possible. L’ouvrier
quant à lui est assuré d’un certain
revenu en cas d’aléa, ce qui est
évidemment un mieux » (11), mais
dont certains travailleurs, moins
conscients, ont tendance à gratifier
l’État qui l’organise alors que c’est
l’ouvrier qui le finance en totalité, ce
qui est un des facteurs qui amène,
bureaucrates syndicaux et petits
bourgeois de gauche, à réclamer toujours
plus d’État bourgeois. Ce que ne font
pas les ouvriers plus conscients qui se
désintéressent de l’État, de son
parlementarisme, de sa gouvernance et de
l’électoralisme, ce qui est un signe de
maturité politique de la conscience de
classe prolétarienne contre lequel
s’échine la gauche moyenne.
Ce
mouvement d’étatisation s’est consolidé
au cours du 19e siècle, pour
s’affiner par la suite, poussé par tout
ce que les pays occidentaux comptaient
de socialistes, de communistes, et de
gauchistes. En prenant en charge de plus
en plus de fonctions, et notamment la
gestion du rapport salarial, et même
l’activité de grève (loi antiscab,
règlementation des activités de grève,
injonction et judiciarisation des luttes
syndicales, droit du travail) « l’État
apparait en même temps comme une
puissance indépendante arbitrale
au-dessus de tous les individus (hors
classe sociales) et décidant pour eux,
pour le mieux pour chacune des
« parties ». En même temps, cela exige
le développement d’un appareil
spécialisé énorme, formellement à part,
qui ne se présente plus ni comme
l’association des citoyens, ni même
comme simple appendice patronal. À la
racine de ce mouvement, il y a la
croissance industrielle, le
développement de la machinerie et la
concentration du capital que cela
implique, la propriété privée devenant
propriété capitaliste collective
(sociétés par actions). Le capital
s’affirme comme rapport de classes :
moyens du travail socialisés, mais dans
une propriété capitaliste elle-même
collectivisée aux mains d’une classe
privilégiée. De sorte que l’ensemble des
conditions de la production se
socialisant, échappant à toute maitrise
individuelle bien que soit toujours
affirmée la fiction de l’individu privé
et de la production privée, elles
doivent aussi être de plus en plus
prises en charge socialement. Donc par
l’État puisqu’il est le représentant de
la société, de la puissance sociale que
ne peuvent avoir les individus privés »
(12).
L’essence du rapport que l’État
entretien avec la société civile se
confirme dans leurs transformations
réciproques puisque l’État, en se
développant, contribue à vider les
individus de la société civile
bourgeoise de leur puissance et de leurs
responsabilités. Certes, on pourra
toujours observer, comme preuve
apparente de ce que l’État est aux mains
de la bourgeoisie, que le personnel
dirigeant de l’État est en général issu,
à peu près exclusivement, des rangs
bourgeois. Certes, car les
connaissances, l’argent, l’enseignement,
les idées et les modes de penser
dominants, les relations, sont la
propriété des bourgeois. Ils affirment
dans l’État aussi ces divisions
sociales. Mais d’une part, cela n’est
pas toujours le cas, et il arrivera à la
bourgeoisie de devoir « prêter » son
pouvoir afin de conserver la société
capitaliste dans son intégralité. On
comprendra que les luttes que mena la
gauche – toutes les gauches – pour
maintenir le pouvoir bourgeois dans ses
formes « démocratique-parlementaires »
contre les formes autoritaires
totalitaires (corporatisme, fascisme,
militarisme, national-socialisme,
stalinisme, colonialisme, etc.) fut une
bataille d’arrière gardes dans
lesquelles ils appelèrent au sacrifice
suprême des milliers d’ouvriers en pure
perte pour la révolution prolétarienne.
La démobilisation des résistants de
gauche à la fin des hostilités était
inscrite dans les motifs de leur
mobilisation. Il en sera de même
aujourd’hui que l’on cherche à mobiliser
les ouvriers pour contrer le terrorisme,
contrer la Russie « postsoviétique »,
contrer le péril chinois, lançant le
prolétariat d’Occident contre les
prolétariats de ces contrées excentrées.
Les
fonctions de l’État bourgeois
s’élargissent inexorablement, au
détriment de la société civile, de ses
organisations qui deviennent ses
appendices subventionnés, entravés, des
rapports privés qui sont de plus en plus
régis par les lois et règlements de
l’État de droit du profit, et qui en
redemandent, étant ainsi graduellement
dépossédées de tout pouvoir sur les
conditions de leur existence. Ce que
Marx voyait très bien dès 1852 quand il
écrivait que l’accroissement « (…)
de la division du travail à l’intérieur
de la société bourgeoise créait de
nouveaux groupes d’intérêts, donc de la
matière nouvelle pour l’administration
de l’État. Chaque intérêt commun fut
immédiatement distrait de la société,
pour lui être opposé comme intérêt
supérieur, général, arraché à l’activité
autonome des membres de la société pour
être l’objet de l’activité
gouvernementale, depuis le pont, la
maison d’école, la propriété communale
d’une commune rurale, jusqu’aux chemins
de fer, aux biens nationaux et à
l’Université de France » (13).
L’État
de droit bourgeois est un monstre aux
mains de la bourgeoisie cupide, et de
serviteurs stipendiés du capital, ce qui
ne signifie surtout pas que l’État
pourrait être un instrument de
développement aux mains d’hommes
vertueux, dévoués, « de gauche » ou « de
La gauche véritable ». L’État bourgeois,
et c’est le seul état possible de l’État
sous le mode de production capitaliste
(même dans ses formes « socialistes » ou
totalitaires) est par nature un rapport
de dépossession, une forme particulière
de domination, de répression et
d’aliénation de classe, l’ultime
aliénation. Cela d’autant plus qu’il
absorbe progressivement une puissance
sociale dont sont dépouillés,
corrélativement, les individus et leurs
associations.
Les
prolétaires révolutionnaires ne doivent
en aucun cas batailler pour prendre le
contrôle d’une portion quelconque, d’une
instance quelconque de la gouvernance
bourgeoise, ce qui comprend les
syndicats, les ONG et autres
organisations de la société civile
subventionnée stipendiée par l’État
embourgeoisé. La révolution
prolétarienne aura pour première tâche
de détruire l’État bourgeois et ses
dépendances.

(1)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
(2)
Dans l’histoire, chaque mode de
production s’est d’abord développé sous
une gouvernance libérale, pour ensuite
évolué – réagissant aux contradictions
antagonistes mettant aux prises les
forces productives et les rapports de
production trop étroits – vers un mode
de gouvernance autoritaire dans une
veine tentative de réguler ces
contradictions et de maintenir les
anciens rapports de production de
domination. Ainsi, le mode de production
féodale a produit le régime royal
aristocratique par cooptation
seigneuriale jusqu’à l’imposture
dynastique héréditaire de droit divin
(sic). Ainsi, le mode de production
capitaliste a produit le démocratisme
électoraliste bourgeois jusqu’au
totalitarisme fasciste et ses variantes
de l’Ère de l’Impérialisme déclinant.
(3)
Karl Marx (1968). L’idéologie
allemande. Éditions sociales. Paris.
Page 74.
(4)
Robert Bibeau (2016). La finalité du
mode de production capitaliste.
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/217913/
(5)
Karl Marx (1968). L’idéologie
allemande. Éditions sociales. Paris.
Page 31.
(6)
Karl Marx (1969). Le 18 Brumaire de
Louis Bonaparte. Éditions sociales.
Paris.
(7)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
(8)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
(9)
François Xavier Merrien (2000). L’État
providence. Que sais-je ? PUF. Page 14.
(10)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
(11)
Karl Marx (1969). Le 18 Brumaire de
Louis Bonaparte. Éditions sociales.
Paris.
(12)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
(13)
Tom Thomas (2011). Étatisme contre
libéralisme ? Démystification
éditeur. Paris. 200 pages. Source URL :
http://www.demystification.fr/les-livres-de-tom-thomas-2/etatisme-contre-liberalisme/
 Le sommaire de Robert Bibeau
Le sommaire de Robert Bibeau
 Le dossier
Monde
Le dossier
Monde
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

