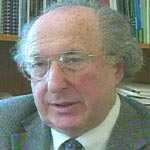|
In London Review Of Books, vol. 29, n° 16,
16 août 2007 Lorsqu’Ehud Olmert et George Deubeuliou
Bush se rencontrèrent, à la Maison Blanche, en juin de cette année,
ils tirèrent la conclusion que l’éviction violente du Fatah de
la bande de Gaza par le Hamas – qui mit fin au gouvernement
palestinien d’union nationale goupillé par les Saoudiens à la
Mecque, au mois de mars – venait de donner au monde une nouvelle
« fenêtre d’opportunité » *. (Jamais un processus
de paix calamiteux n’avait jusqu’ici bénéficié de si
nombreuses fenêtres d’opportunité !). L’isolement du
Hamas dans Gaza, pensèrent ensemble Olmert et Bush, leur
permettrait d’accorder des concessions généreuses au président
palestinien Mahmoud Abbas, ce qui lui aurait donné la crédibilité
dont il avait bien besoin auprès du peuple palestinien pour
s’imposer au Hamas. Tant Bush qu’Olmert ont été intarissables
sur leur engagement en matière de solution à deux Etats pour le
conflit israélo-palestinien, mais c’est leur détermination à
en finir avec le Hamas, plutôt que celle d’édifier un Etat
palestinien, qui anime leur enthousiasme tout neuf à donner une
bonne image d’Abbas. C’est la raison pour laquelle leur espoir
que le Hamas finisse par perdre est totalement illusoire. Les modérés
palestiniens ne prévaudront jamais sur les Palestiniens considérés
extrémistes, dès lors que ce qui définit la modération, chez
Olmert, c’est l’approbation par les Palestiniens du démembrement
par Israël de leur propre territoire. A la fin des fins, ce qu’Olmert
et son gouvernement sont prêts à offrir aux Palestiniens sera
rejeté non moins par Abbas lui-même que par le Hamas, et cela ne
fera que confirmer aux yeux des Palestiniens la futilité de la
modération d’Abbas, et justifier le rejet de cette modération
fatale par le Hamas. Tout aussi illusoires sont les expectatives
de Bush concernant ce qui sera apporté par la conférence qu’il
a récemment annoncée pour l’automne (conférence qui vient
d’être ramenée à une simple « réunion », sans
plus). A ses yeux, toutes les initiatives de paix précédentes
ont échoué, dans une large mesure, sinon exclusivement, parce
que les Palestiniens n’auraient pas été prêts à prendre en
charge un Etat qui leur fût propre. Cette réunion, par conséquent,
se concentrera étroitement à l’édification d’institutions
palestiniennes et aux réformes attendues dans leur gouvernance,
sous la tutelle de Tony Blair, nouvellement nommé envoyé spécial
du Quartette… En réalité, toutes les initiatives de paix
précédentes n’ont abouti à rien, pour une raison que ni Bush,
ni l’Union européenne n’ont eu le courage de reconnaître.
Cette raison, c’est le consensus réalisé depuis fort longtemps
par les élites décisionnaires en Israël, sur le fait qu’Israël
ne permettra jamais l’émergence d’un Etat palestinien qui remît
en cause son contrôle effectif, tant militaire qu’économique,
sur la Cisjordanie. A n’en pas douter, Israël est prêt à
permettre – que dis-je, il insistera sur – la création d’un
certain nombre d’enclaves isolées, que les Palestiniens
pourraient toujours appeler « Etat », si ça leur
chante, mais à seule fin d’empêcher la création d’un Etat
binational, dans lequel les Palestiniens seraient démographiquement
majoritaires. Le processus (dit) de paix au Moyen-Orient
risque fort de devenir la couillonnade la plus spectaculaire de
toute l’histoire de la diplomatie moderne. Depuis le flop du
sommet de Camp David, en 2000, et même en réalité, bien avant
ce sommet calamiteux, l’intérêt d’Israël dans un quelconque
processus de paix – mis à part celui d’obtenir des
Palestiniens et du concert des nations une acceptation du statu
quo – n’est qu’une fiction qui a essentiellement servi à
fournir une couverture à sa confiscation systématique de
territoires palestiniens et à une occupation dont l’objectif,
d’après l’ancien chef d’état major de l’armée israélienne,
Moshe Ya’alon, est de « faire rentrer profondément dans
la conscience des Palestiniens qu’ils sont un peuple vaincu ».
Par son adoption sans enthousiasme des accords d’Oslo, et par
son dégoût pour les colons, Yitzhak Rabin a sans doute été
l’exception qui confirme la règle, mais même lui n’a jamais
envisagé une restitution de territoire palestinien allant au-delà
du plan dit Allon, qui permettait à Israël de conserver la vallée
du Jourdain ainsi que d’autres parties de la Cisjordanie. Quiconque connaît un tant soit peu les
confiscations incessantes de territoire palestinien par Israël
– fondées sur un plan imaginé, supervisé et mis en œuvre par
Ariel Sharon – sait bien que l’objectif de son entreprise de
colonisation en Cisjordanie est d’ores et déjà en grande
partie atteint. Gaza, dont l’évacuation des colonies a été si
naïvement saluée par la communauté internationale qui s’est
plu à y voir la geste héroïque d’un homme tout récemment
converti à une paix honorable avec les Palestiniens, n’était
que la première création de toute une série de bantoustans
palestiniens. La situation à Gaza nous donne une idée de ce dont
auront l’air ces bantoustans au cas où leurs habitants ne se
comporteraient pas conformément aux desiderata d’Israël.
C’est, précisément, l’engagement hypocrite d’Israël dans
un soi-disant processus de paix et une solution à deux Etats qui
a rendu possible son occupation à durée indéterminée et son démembrement
du territoire palestinien. Et le Quartette – l’Union européenne, le
secrétaire général de l’Onu et la Russie suivant avec obéissance
la ligne de Washington- a trempé dans cette tromperie, lui
accordant une couverture en acceptant le prétexte invoqué par
Israël qu’il n’aurait pas été en mesure de trouver un
partenaire de paix palestinien méritant. Un an, tout juste, après la guerre de 1967,
Moshe Dayan, un ancien chef d’état major de l’armée israélienne
qui était, à l’époque, ministre de la Défense, interrogé
sur ses projets pour le futur, répondit qu’il s’agissait
« de la réalité présente dans les territoires ».
« Le projet », avait-il dit, « est en train d’être
mis en œuvre, sous la forme de faits accomplis. Ce qui existe
aujourd’hui doit demeurer un arrangement permanent au
Moyen-Orient. » Dix ans plus tard, lors d’une conférence
à Tel-Aviv, le même Dayan déclara : « La question
n’est pas de savoir « Quelle est la solution ? »,
mais « Comment pouvons-nous vivre sans solution ? » ».
Geoffrey Aronson, qui a surveillé l’entreprise de colonisation
depuis le début, résume ainsi qu’il suit la situation : Vivre sans solution, à l’époque comme de
nos jours, c’était compris par Israël comme la clé permettant
de maximiser les bénéfices de la conquête, tout en minimisant
les charges et les dangers d’un retrait, comme ceux d’une
annexion formelle. Ce pari sur le statu quo, toutefois, masquait
un programme d’expansion, que des générations successives de
dirigeants israéliens ont soutenu, car elle permettait, à leurs
yeux, la transformation dynamique des territoires et l’extension
d’une souveraineté israélienne effective jusqu’au Jourdain. Au cours d’une interview accordée au
quotidien israélien Ha’aretz, en 2004, Dov Weissglas, chef de
cabinet d’Ariel Sharon, Premier ministre à l’époque, présenta
l’objectif stratégique de la diplomatie sharonienne comme
consistant à garantir du soutien de la Maison Blanche et du Congrès
américain à des mesures israéliennes susceptibles de mettre
tant le processus de paix que l’Etat palestinien « dans le
formol ». C’était là une métaphore diaboliquement adéquate :
en effet, le formaldéhyde a pour principal intérêt d’empêcher
les corps morts de se détérioré, allant jusqu’à créer,
parfois, l’illusion qu’ils seraient encore en vie. Weissglas
explique que l’objet du retrait unilatéral de Gaza et du démantèlement
de plusieurs colonies isolées en Cisjordanie, était de conquérir
l’acceptation de l’unilatéralisme israélien par les
Etats-Unis, et non de créer un quelconque précédent en vue
d’un éventuel retrait de Cisjordanie. Ces retraits partiels
visaient à fournir à Israël l’espace politique lui permettant
d’approfondir et d’élargir sa présence en Cisjordanie, et
c’est effectivement ce qu’ils ont permis. Dans une lettre
adressée à Sharon, Bush écrivait : « A la lumière
des nouvelles réalités sur le terrain, y compris en ce qui
concerne les grands centres de population israéliens, il serait
irréaliste d’escompter que les négociations finales aient pour
effet un retour total et complet aux lignes d’armistice de 1949. » Dans une interview récemment publiée par
Ha’aretz, James Wolfensohn, qui était représentant du
Quartette au moment du désengagement unilatéral (israélien) de
Gaza, déclara qu’Israël et les Etats-Unis avaient systématiquement
sapé l’accord qu’il espérait obtenir, en 2005, entre Israël
et l’Autorité palestinienne, et transformé, en revanche, Gaza
en une immense prison. Le responsable de cet état de fait, déclara-t-il
à Ha’aretz, c’était Elliott Abrams, vice-conseiller en matière
de sécurité nationale des Etats-Unis. « Jusque dans les
moindres détails, tous les aspects, sans exception, de l’accord
sponsorisé par Wolfensohn, furent « abrogés ». Une autre interview récente publiée par
Ha’aretz, cette fois-ci de Haggai Alon, qui fut un conseiller
important d’Amir Peretz au ministère de la Défense, est encore
plus révélateur. Alon accuse l’armée israélienne (dont un
nombre croissant d’officiers supérieurs sont eux-mêmes des
colons) d’œuvrer clandestinement à la promotion des intérêts
des colons. L’armée israélienne, dit Alon, ignore royalement
les instructions de la Cour Suprême au sujet du tracé que doit
suivre l’ainsi dite ‘muraille de sécurité’, choisissant,
au contraire, un tracé rendant impossible la création d’un
quelconque Etat palestinien ». Alon a déclaré à
Ha’aretz qu’après que des hommes politiques israéliens
eurent signé, en 2005, un accord avec les Palestiniens prévoyant
d’alléger les restrictions imposées aux déplacements des
Palestiniens dans les territoires (comme partie du marché auquel
avait œuvré Wolfensohn), l’armée avait allégé les
restrictions de déplacement imposées… aux colons ! Pour
les Palestiniens, le nombre des barrages routiers doubla. D’après
Alon, l’armée israélienne « est en train de mettre en œuvre
une politique d’apartheid », qui vide Hébron de ses
habitants arabes et judaïse (c’est le terme qu’il a employé
lui-même) la vallée du Jourdain, tout en coopérant
exclusivement avec les colons, dans la claire intention de rendre
impossible toute solution basée sur deux Etats. Une nouvelle carte de la Cisjordanie (de l’Onu),
dressée par le Bureau pour la Coordination des Questions
Humanitaires, donne une vision globale de la situation.
L’infrastructure israélienne, civile et militaire, a exclu non
moins de 40 % du territoire palestinien inaccessibles aux
Palestiniens. Le reste du territoire palestinien [ce qualificatif,
« palestinien », désigne, sous la plume de
l’auteur, les territoires arabes confisqués à la suite de
l’agression de l’entité sioniste, en juin 1967, et non pas,
au sens propre, les territoires arabes (appelons-les palestiniens)
usurpés par l’entité sioniste à la suite de son implantation
par les stalino-américains, en 1948. ndt] Le reste du territoire,
y compris des centres de population importants, tels les villes de
Naplouse et de Jéricho, est éclaté en enclaves disjointes ;
les mouvements entre ces enclaves-bantoustans sont entravés par
quelque 450 barrages routiers et 70 checkpoints militaires.
L’Onu a fait le constat que ce qui reste des territoires
‘palestiniens’ constitue une superficie très similaire à
celle qui était jetée comme os à ronger à la population
palestinienne, dans les propositions sécuritaires israéliennes
consécutives à la guerre de 1967. Elle a également constaté
que les changements en cours apportés à l’infrastructure
desdits territoires – dont un réseau d’autoroutes contournant
et isolant les villes palestiniennes – ne sauraient avoir
d’autre but que celui de formaliser le saucissonnage de facto de
la Cisjordanie. Telles sont les réalités, sur le terrain,
qu’un blabla non-informé et / ou cynique, à Jérusalem,
Washington et Bruxelles, au sujet des attentes vis-à-vis des
Palestiniens qu’ils réforment leurs institutions, démocratisent
leur culture (sic !), démantèlent les « infrastructures
terroristes » et mettent un terme à la violence et aux
incitations à la violence en préalable à des négociations de
paix cherche à faire oublier. Etant donné l’immense déséquilibre
de pouvoir entre Israël et les Palestiniens – pour ne pas
parler de la très large prépondérance du soutien diplomatique
dont jouit Israël, précisément des pays dont on aurait attendu
qu’ils compensent, diplomatiquement, le déséquilibre militaire
criant – rien ne changera en mieux tant que les Etats-Unis, l’Union
européenne et les autres actants internationaux ne regarderont
pas en face quels sont depuis fort longtemps les obstacles
fondamentaux à la paix. Parmi ces obstacles, il y a l’assomption,
implicite dans l’occupation israélienne, qu’à défaut de
l’obtention d’un accord de paix, le « règlement par défaut »
campé par la Résolution 242 du Conseil de Sécurité serait la
poursuite sine die de l’occupation israélienne. Si cette
lecture avait une once de vérité, cette résolution ne serait
pas autre chose que l’invitation lancée à toute puissance
occupante le désirant à conserver le territoire de son
adversaire, tout simplement, en évitant soigneusement tous
pourparlers de paix – ce qui est, à la lettre, ce qu’Israël
est en train de faire. De fait, la déclaration préliminaire de
la Résolution 242 dit qu’un territoire ne saurait être acquis
par la force armée, ce qui implique qu’au cas où les parties
au conflit ne parviennent pas à un accord, l’occupant doit se
retirer jusqu'au rétablissement du statu quo ante : tel est,
en toute logique, la véritable implication par défaut de la Résolution
242. Y eût-il eu une intention sincère, de la part d’Israël,
de se retirer des territoires qu’il occupe, alors, assurément,
quarante ans auraient été plus que suffisants pour parvenir à
un accord. Les récusations israéliennes consistent
depuis longtemps à invoquer le fait qu’il n’existait pas d’Etat
palestinien avant la guerre de juin 1967, et qu’il n’existe
donc pas de frontière internationalement reconnue sur laquelle
Israël puisse se retirer, la frontière antérieure au conflit
n’étant rien de plus qu’une ligne d’armistice. De plus, étant
donné que la 242 en appelle à une « paix juste et durable »,
qui permette « à tout pays dans la région de vivre en sécurité »,
Israël maintient qu’il doit être autorisé à modifier la
ligne d’armistice, soit bilatéralement, soit à défaut unilatéralement,
afin de la rendre sûre avant de mettre fin à l’occupation.
C’est là un argument spécieux à plus d’un titre, mais
principalement en raison du fait que la Résolution 181, de
Partage de la Palestine, adoptée par l’Assemblée Générale
des Nations Unies en 1947, qui a établi la légitimité
internationale de l’Etat juif, reconnaissait le territoire
palestinien situé au-dehors des frontières du nouvel état comme
le patrimoine légitime de la population arabe palestinienne, sur
lequel celle-ci était fondée à créer son propre Etat, et cette
résolution cartographiait les limites de ce territoire avec une
très grande netteté. L’affirmation par la 181 du droit de la
population arabe de Palestine à l’autodétermination nationale
était fondée sur le droit normatif et sur les principes démocratiques
garantissant une nationalité à la population majoritaire. (A
l’époque, les Arabes représentaient les deux tiers de la
population de la Palestine). Ce droit ne saurait s’évaporer au
seul motif de retards apportés à sa mise en application. Dans le cours d’une guerre lancée par des
pays arabes cherchant à empêcher la mise en application de la résolution
de partage de l’Onu, Israël a agrandi son territoire de 50 %.
S’il est illégal d’acquérir du territoire en résultat
d’une guerre, alors on ne saurait concevoir que la question posée
aujourd’hui soit celle de savoir quelle superficie additionnelle
de territoires palestiniens Israël serait-il fondé à confisqué,
mais bien au contraire, quelle proportion des territoires
palestiniens conquis durant la guerre de 1948 Israël est-il
autorisé à conserver ! Si, à l’extrême rigueur, des
« ajustements » doivent absolument être apportés à
la ligne d’armistice de 1949, alors qu’ils soient opérés du
côté israélien, et certainement pas du côté palestinien de
ladite ligne ! A l’évidence, l’obstacle à la résolution
du conflit israélo-palestinien n’a pas été un manque
d’initiatives de paix, ou d’envoyés spéciaux de paix. Ce
n’a pas non plus été la violence à laquelle les Palestiniens
ont dû avoir recours dans leur combat pour se débarrasser de
l’occupation israélienne, même lorsque cette violence a
bassement pris pour cible la population civile israélienne. Ce
n’est en aucune manière approuver l’assassinat de civils que
d’observer qu’une telle violence finit par se produire, tôt
ou tard, dans la plupart des situations où l’aspiration d’un
peuple à son autodétermination est frustrée par une puissance
occupante. De fait, le combat d’Israël lui-même en vue de son
indépendance nationale n’a pas échappé à cette règle.
D’après l’historien (israélien) Benny Morris, dans ce
conflit, c’est l’Irgoun qui, le premier, prit pour cible des
civils. Dans son ouvrage Righteous Victims, [Victimes. Histoire
revisitée du conflit arabo-sioniste. Editions Complexe, 29,90 €uros,
20,93 €uros sur Numilog http://www.numilog.com/fiche_livre.asp?id_livre=7157&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD
], Morris écrit que l’irruption du terrorisme arabe, en 1937,
« déclencha une vague d’attentats à la bombe de l’Irgoun
contre des foules et des autobus arabes, introduisant une
dimension nouvelle dans le conflit. » Si, par le passé, des
Arabes avaient « visé des voitures et des piétons, et éventuellement
lancé une grenade ici ou là, tuant, souvent, ou blessant
quelques badauds ou quelques passagers », désormais,
« pour la première fois, des bombes puissantes étaient
placées dans des centres arabes où évoluaient une foule de
civils, et des dizaines de personnes furent ainsi assassinées ou
mutilées de manière aveugle ». Morris note que « cette
innovation ne tarda pas à trouver des Arabes pour l’imiter. » Venant souligner la volonté israélienne de
conserver les territoires occupés, il y a le fait que ce pays
n’a jamais véritablement considéré que la Cisjordanie fût un
territoire occupé, en dépit de son acceptation pro forma de
cette désignation. Les Israéliens voient plutôt dans les
territoires palestiniens un territoire « contesté »,
sur lequel ils ont des revendications non moins légitimes que
celles des Palestiniens, quoi qu’en disent le droit
international et les résolutions de l’Onu. C’est là une
vision des choses qui fut rendue explicite pour la première fois
par Sharon dans une tribune publiée en première page du New York
Times le 9 juin 2002. L’utilisation des termes bibliques de Judée
et Samarie pour désigner les territoires – des termes qui n’étaient
jadis employés que par le seul Likoud, mais qui sont
aujourd’hui ‘de rigueur’ [en français dans le texte, ndt] y
compris chez les piliers du parti travailliste – reflète
l’opinion unanime en Israël. Le fait que l’ancien Premier
ministre Ehud Barak (aujourd’hui, ministre de la Défense d’Olmert)
décrive sans cesse les propositions territoriales qu’il avait
formulées lors du sommet de Camp David comme des preuves de la
« générosité » d’Israël, et jamais comme une
reconnaissance des droits des Palestiniens, n’est qu’un
exemple supplémentaire de cette mentalité. De fait, l’entrée
« droits des Palestiniens » semble inexistante dans le
dictionnaire israélien. Le problème n’est pas, contrairement à ce
qu’affirment souvent les Israéliens, que les Palestiniens ne
sachent pas faire de compromis (un autre ancien Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, s’était illustré en se
plaignant du fait que « les Palestiniens ne savent que
prendre, et Israël ne cesse de donner »). C’est là, en
l’occurrence, une accusation parfaitement indécente, étant
donné que ce sont les Palestiniens qui ont fait le plus gros du
compromis allant loin s’il en fut, lorsque l’OLP reconnut de
manière formelle la légitimité d’Israël à l’intérieur
des frontières d’armistice de 1949. Par cette concession, les
Palestiniens renonçaient à leur revendication portant sur plus
de la moitié du territoire assigné à la population arabe par la
résolution de partage de la Palestine adoptée par l’Onu. Cette
concession extrême n’a jamais été portée à leur crédit,
alors qu’ils l’avaient faite plusieurs années avant qu’Israël
eut reconnu le droit des Palestiniens à une nationalité dans
n’importe quelle partie de la Palestine. La notion selon
laquelle de futurs ajustements de frontières pourraient être opérés
au détriment des 22 % du territoire encore palestinien est
profondément offensant à leur égard, on le comprendra aisément. Néanmoins, au sommet de Camp David, les
Palestiniens ont accepté des ajustements à la frontière antérieure
à 1967, qui permettraient à de nombreux colons en Cisjordanie
– environ 70 % d’entre eux – de rester à l’intérieur de
l’Etat juif, pour peu que les Palestiniens se voient allouer des
territoires comparables du côté israélien de la frontière.
Barak a rejeté cette proposition. A n’en pas douter, par le
passé, l’exigence par les Palestinien de leur droit au retour
représentait un obstacle sérieux à tout accord de paix. Mais
l’initiative de paix de la Ligue Arabe, en 2002, ne laisse aucun
doute sur le fait que les Arabes accepteront un retour nominal et
symbolique de réfugiés palestiniens en Israël, comme pays de résidence,
ou dans d’autres pays prêts à les accueillir. C’est l’incapacité de la communauté
internationale de rejeter (sinon dans une rhétorique vide) la
notion israélienne selon laquelle l’occupation et la création
de « faits accomplis sur le terrain » pourrait se
poursuivre indéfiniment, dès lors qu’il n’y a pas d’accord
qui soit jugé acceptable par Israël, qui a fait échouer toutes
les initiatives de paix jusqu’ici, ainsi que les efforts de tous
les envoyés de paix, sans exception. Des initiatives futures sont
vouées au même sort, si cette question fondamentale n’est pas
réglée. Pour une réelle avancée, ce qui est
indispensable, c’est l’adoption, par le Conseil de Sécurité,
d’une résolution affirmant ce qui suit : 1) des
modifications ne peuvent être apportées à la situation antérieure
à 1967 qu’à la condition expresse d’un accord entre les deux
parties et que des mesures unilatérales ne sauraient se voir
reconnues internationalement ; 2) la clause par défaut de la
résolution 242, réitérée par la résolution 338 (résolution
de cessez-le-feu après la guerre d’octobre 1973), consiste en
le retour des forces d’occupation israéliennes à l’intérieur
des frontières antérieures à la guerre de juin 1967 ;
enfin, 3) si les parties ne parviennent pas à un accord dans les
douze mois (la mise en application de ces accords prenant
naturellement beaucoup plus de temps, la mise en application par défaut
sera imposée par le Conseil de Sécurité. Celui-ci adoptera
alors ses propres termes en vue d’une fin du conflit, et il se
mettra d’accord sur une force internationale chargée de pénétrer
dans les territoires occupés afin d’y établir l’état de
droit, et d’y aider les Palestiniens à mettre sur pied leurs
institutions, de garantir la sécurité d’Israël en empêchant
toute action violente transfrontalière, et en surveillant et
supervisant la mise en application des mesures assurant la fin du
conflit. Notes : Voir par ailleurs, à la page 31 de ce même numéro, l’article de Rashid Khalidi consacré au Hamas et au Fatah. Henry Siegman, directeur du US/ Middle East Project, a été doyen du Council on Foreign Relations de 1994 à 2006. Il a été, par ailleurs, directeur du Congrès Juif Américain, de 1978 à 1994. |
|
|
Source et traduction : Marcel Charbonnier |
Avertissement
Palestine - Solidarité a pour vocation la diffusion
d'informations relatives aux événements du Moyen-Orient et de
l'Amérique latine.
L' auteur du site travaille à la plus grande objectivité et au respect des opinions
de chacun, soucieux de corriger les erreurs qui lui seraient signalées.
Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que la responsabilité
de leur auteur et/ou de leur traducteur. En aucun cas Palestine -
Solidarité ne saurait être
tenue responsable des propos tenus dans les analyses, témoignages et
messages postés par des tierces personnes.
D'autre part, beaucoup d'informations émanant de sources externes, ou
faisant lien vers des sites dont elle n'a pas la gestion, Palestine -
Solidarité n'assume
aucunement la responsabilité quant à l'information contenue dans ces
sites.
Pour
contacter le webmaster, cliquez <
ici >